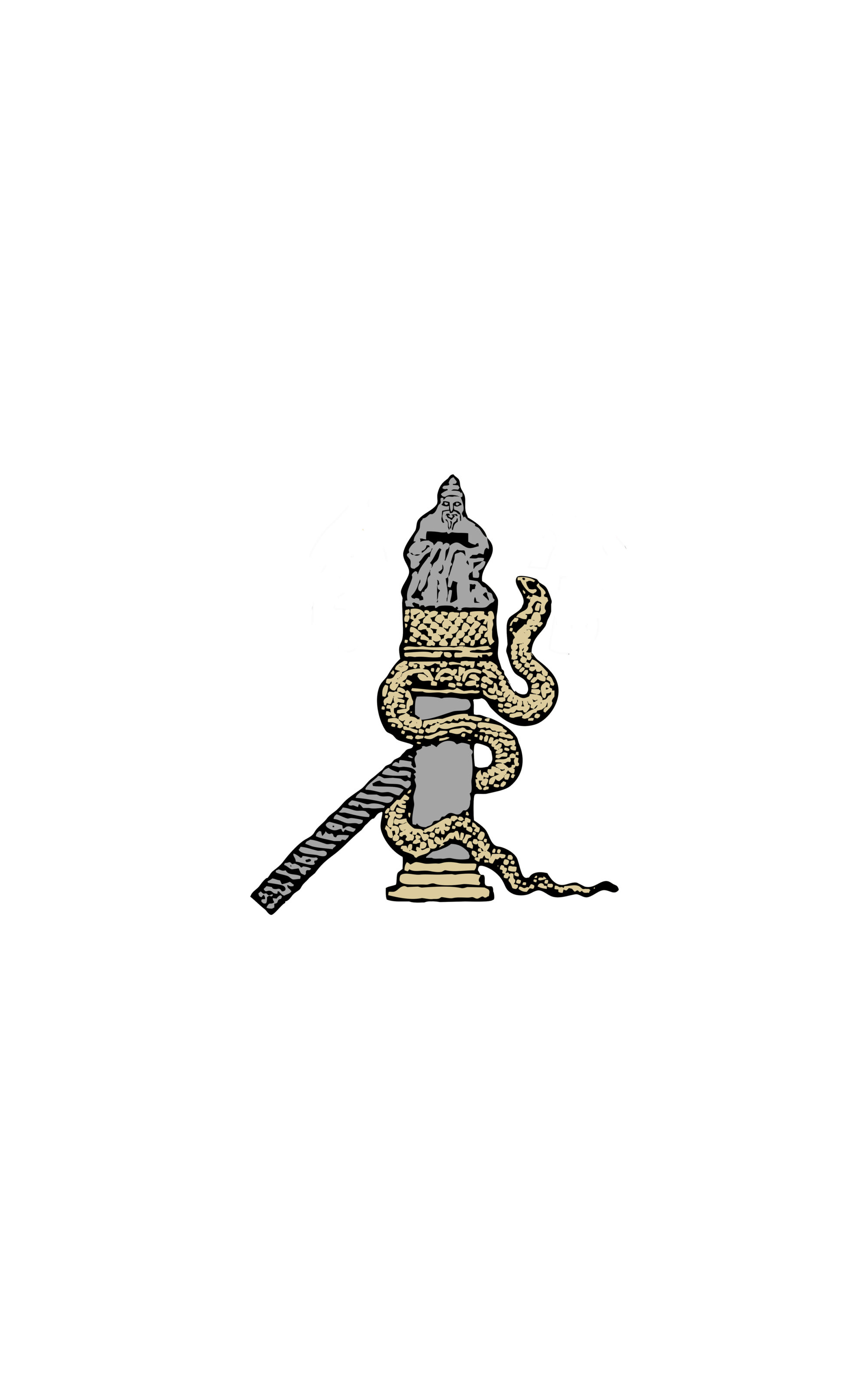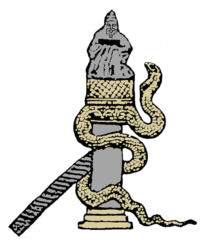IVe édition des Rencontres annuelles des doctorants en études byzantines
21-22 octobre 2011
Institut National d’Histoire de l’Art (Paris)
Résumés des communications.
The demoniacal influences of Late Antiquity in early Byzantine hagiography: the black demons of the Life of Simeon the Fool.
Javier Fuertes, université de Cantabria
Through demoniacal epiphanies contained in the Life of Symeon the Fool, written by bishop Leontius of Neapolis, this work aims to study the influence of cultural Late Antiquity’s notions in early Byzantine hagiography, analyzing the traditions which explain and justify the black appearance of demons in that work.
The author begins by describing demon’s epiphanies in the text, where evil spirits are described as dogs, terrifying spirits or Ethiopians, but always black, placing them in the narrative context of the story. Then, he combines both historical and anthropological approaches to analyze the precedents and parallels of this particular dark appearance in order to understand its origins and explanation. Finally, the author concludes that these epiphanies are drawn not only from the image of darkness associated with the evil forces in the evangelical literature but also from pagan traditions about daimones as well as from certain Greco-Roman prejudices regarding somatic and racial archetypes.
La popularité énigmatique de l’apologue de la licorne du récit de Barlaam et Joasaph.
Iphigeneia Debruyne, Université de Provence
L’apologue de la licorne est un des dix apologues d’origine bouddhique intégré dans le récit grec de Barlaam et Joasaph, la première version chrétienne de la vie du prince Joasaph, un texte hagiographique et édifiant. Il s’agit de l’un des dix apologues du récit qui sont définis comme de leçons morales au préalable étrangères au monde chrétien. L’apologue de la licorne se distingue des neuf autres apologues intégrés dans le récit chrétien par les représentations figurant non seulement dans les manuscrits enluminés de Barlaam et Joasaph mais aussi indépendamment du texte. A Byzance, l’image de l’apologue de la licorne est, entre autres, illustrée dans des psautiers à illustrations marginales. En Occident, le bas-relief de Ferrare affirme l’autonomie que l’apologue de la licorne avait acquise depuis Byzance. L’apparition constante de l’apologue en dehors du contexte du récit témoigne d’une popularité dite énigmatique, d’une popularité dont les raisons méritent encore d’être explorés.
D’une part l’examen du cheminement littéraire de l’apologue de la licorne qui dépasse les frontières de la migration littéraire du récit de Barlaam et Joasaph, une étude des illustrations associées à l’apologue de la licorne du récit menée afin de déterminer d’éventuels prototypes et de la multitude de voies à travers lesquelles l’image et/ou le texte se diffusent, et d’autre part la comparaison des images de l’apologue issues de différents contextes littéraires, autorise de penser que la popularité de l’apologue n’est pas si énigmatique qu’elle ne le semble.
L’attestation précoce de l’apologue dans le monde chrétien d’Orient, mais aussi sa présence simultanée dans le recueil de fables arabe du VIIIe siècle, Kalîla wa Dimna, expliquent aisément la popularité de l’apologue. De même, cette recherche invite à proposer de nouvelles interprétations pour des images auparavant associées à l’apologue de la licorne du récit de Barlaam et Joasaph.
Les prisonniers de guerre selon les Vies de Saints (VIe-XIe s.).
Marilia Lykaki, École pratique des Hautes Études / Université d’Athènes
Il s’agit d’un phénomène militaire, diplomatique et social qui touche aussi les domaines de la culture et de la communication et qui montre, enfin, l’image que Byzance avait des autres et de soi-même. La captivité était une situation transitoire qui conduisait soit à l’esclavage soit à la libération. Pendant ce temps, on voit les captifs assumer des rôles divers : comme soldats, agriculteurs, porteurs d’idéologie, de culture et de savoirs. Ma recherche commence à une époque où l’attitude à l’égard des prisonniers de guerre héritée du monde romain est en train de changer sous l’impact du christianisme ; elle se termine à une période où les échanges des prisonniers avec les Arabes, devenus une routine, perdent de l’actualité et les guerres avec les Bulgares battent le plein. Dans ce contexte, les données fournies par des sources hagiographiques présentent un grand intérêt, étant révélatrices de situations que les sources officielles byzantines passent sous silence où décrivent de façon lapidaire. Ainsi, les sources hagiographiques peuvent renseigner l’historien sur les raisons d’emprisonnement, le contexte historique, la situation des prisonniers et leur affranchissement. La critique relative à la valeur historique des textes hagiographiques a été exercée par plusieurs savants. Je continue ce travail dans le même esprit critique afin de tirer de ces sources les données utiles au sujet de ma thèse.
Remembrance of the Paradise: Tree of Life in Late Byzantine Architecture.
Jasmina S. Ćirić, Université de Belgrade
Paper explores artistic and exegetic contents of the wall surfaces in Late Byzantine church architecture. Taking into consideration that the brick was one of the main facade articulation materials, it is possible to understand the «messages» represented with bricwork geometric ornaments, in critical terms of art history insufficiently identified as «aniconic decoration». Starting from the fact that the ornamental unit represents the image, the same can not contain aniconic but rather highly codified, dehumanized features. Arbor Vitae (xylon zoës, wood of life), motif identified in the key examples of Late Byzantine architecture in the exterior surface of the apse or or obtained by the appropriate positioning of the marble revetments next to the portals of the temple, presents a image of the ancient biblical metaphor “Blessed are those who wash their robes, that they may have the right to the tree of life and may go through the gates into the city” (Revelation 22: 14). Exegetic reading (‘décryptage’) of facade surfaces shows that visible finds its meaning in the invisible, but invisible finds its expression possibilities in the visible. Except the variety with brick represented schematized tree, were registered multidirectional placed geometric motives which that not only corresponds with monogram of Christ but also His Old Testament prefiguration tree of life. Arbor Vitae becomes coded image which shows remembrance of the Paradise where the God “placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and a flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life” (Genesis 3: 24).
L’art d’enfiler des perles. Le genre littéraire byzantin des chapitres.
Katrien Levrie, Université de Louvain
On sait que la civilisation byzantine attachait beaucoup d’importance à sauvegarder la tradition. A cet égard, on peut entre autres constater que la littérature byzantine se caractérise par un effort de compilation. Dans ce rapport écrit, je me pencherai sur un genre de compilation particulier, celui des chapitres ou κεφάλαια. Pendant la période byzantine, plusieurs œuvres théologiques étaient présentées et structurées sous forme de collections de chapitres courts. Le nombre de chapitres pouvait en fait varier, mais en général, les auteurs compilaient un bon nombre de chapitres, souvent 100 (ou un multiple de 100).
Une telle collection de 100 chapitres était nommée centurie ou ἑκατοντάς. Ce qui est toutefois remarquable est qu’il n’existe souvent aucun lien évident entre les différents chapitres qui forment chacun en soi une unité visant à être lue et contemplée. Le genre littéraire des centuries prospérait dans les milieux monastiques où l’ensemble des chapitres avait pour but de stimuler la réflexion et l’ascèse auprès des moines.
Alors, cette sorte de littérature de compilation s’est presque dérobée à la vue des byzantinistes. A cet égard, il a semblé opportun d’examiner ce genre littéraire. Ma recherche se focalise sur la personne de Maxime le Confesseur (6e-7e siècles) et, plus particulièrement, sur deux œuvres qui lui sont attribuées, à savoir les Capita Gnostica (CPG 7707/11) et les De Duabus Christi Naturis (CPG 7697/13). Ces deux textes sont en effet exemplaires pour le genre des chapitres.
Dans cette intervention, je présenterai mon projet de recherche et les constatations que j’ai déjà faites quant au genre des chapitres en préparant une édition critique de ces deux textes.
Capita literature in Byzantium: The Capita Alia by Elias Ekdikos.
Eva De Ridder, Université de Louvain
In research on Byzantine literature, the genre of theological capita has not received the attention it deserves, as is shown by the few articles on this subject that have appeared hitherto. Capita or κεφάλαια form a collection of mystical sayings, each of which can separately act as a starting point for monks to meditate upon. The chapters treat different kinds of spiritual ideas and appear to be put together in random order. Although there are indications that, at least for some capita collections, a well-considered structure is indeed present, the key to unravel this structure has not yet been found.
The Capita alia, also called Anthologium gnomicum and allegedly written by Maximus the Confessor, is a representative of this genre. A critical edition of this work is yet to be made and is as such the aim of my PhD project. As far as we know, manuscript tradition handed down 82 copies, none of which date earlier than the 12th Century.
In my lecture I would like to discuss the different uncertainties that still exist about the Capita alia, starting off with a brief discussion about its unknown authorship. As stated above, in the MSS the Capita alia are often attributed to Maximus the Confessor and infrequently to other well-known authors. However, the greater part of the MSS points out Elias Ecdicus as the author, an ecclesiastic judge presumably from the 11th-12th Century. Apart from the authorship, there is also great variation to be found in the MSS as far as title, structure, and even the number of chapters are concerned.
Furthermore, I will address some of the aforementioned general features of the genre of chapters, as well as focus on more specific characteristics of the Capita alia in particular. At the end, special attention will be paid to the principles of structuralization and to the importance of identifying the most original sequence and structure of the chapters, in order to appreciate this compilation in a more precise way.
La vision du barbare en Orient à l’époque protobyzantine : l’apport des sources syriaques.
Claire Fauchon, Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines
Dans ses analyses sur Byzance, le barbare et l’hérétique, É. Patlagean concluait que dans « la lutte de Byzance contre les peuples qui l’entourent, l’accent est mis désormais sur le motif de la chrétienté, d’une chrétienté qui demeure définie en même temps comme porteuse des valeurs universelles de la romanité ». Fantasmes répulsifs, les barbares sont pourtant loin d’être perçus comme un tout homogène. Notre but est d’étudier comment la notion de barbare et les topoi qui lui sont associés sont utilisés à la haute époque byzantine dans la documentation syriaque, par des populations chrétiennes de l’Empire byzantin, imprégnées de culture gréco-romaine mais dont l’identité même est d’appartenir à un groupe hétérodoxe qui doit résister à plusieurs envahisseurs : perses, puis arabes. Nous nous intéresserons plus particulièrement à un cycle légendaire syriaque connu sous le nom de Légende d’Alexandre. Ce cycle est composé de plusieurs textes rédigés en syriaque entre 629 et 677, au cours d’une période particulièrement trouble en Orient : invasions des Perses, massacres des chrétiens, reconquête byzantine puis invasions arabes. Ces textes mettent en scène Alexandre qui part civiliser les barbares aux confins de l’oikoumene et nous renseignent sur les représentations du barbare à cette époque. Cette documentation syriaque offre un point de vue complémentaire des sources grecques et permet d’examiner, sous un autre angle, les dynamiques socio-culturelles à l’œuvre en Orient, ainsi que la plasticité des stéréotypes et l’ampleur des interactions culturelles à l’œuvre dans ces sociétés orientales multiculturelles et multiconfessionnelles du haut Moyen Âge.
La fête des Broumalia de Rome à Byzance : continuité ou ré-invention idéologique ?
Elena Nonveiller, École des Hautes Études en Sciences Sociales
L’État et l’Église romains d’Orient, dans son histoire millénaire, ont alterné la tendance à interdire et condamner toute une série de fêtes, rites et pratiques religieuses non officielles, dites ‘païennes’ ou ‘démoniaques’, en tant que dangereuses pour la stabilité politique et sociale, avec la tendance à masquer leur hétérodoxie en les assimilant. Très souvent ces formes d’intégration ont produit des synthèses et des syncrétismes religieux très originels, où le paganisme n’est plus dissociable du christianisme. Lorsque les byzantins ont rétabli la célébration de certaines fêtes antiques, ils les ont élaboré et transformé pour les réadapter dans le nouveau contexte historique et socioculturel. Ces adaptations sont passées à travers une forme de ré-invention idéologique du paganisme gréco-romain, en raison de marquer chaque fois une continuité ou une fracture avec le passé pré-chrétien, conformément aux exigences économiques, politiques et sociales du présent. C’est le cas de l’ancienne fête romaine de la bruma qui a été transformée en Broumalia par les Byzantins, à travers un processus de ré-invention idéologique de l’Antiquité.
Dans la présente communication je me propose de remarquer certains aspects de ce processus par l’analyse de deux sources byzantines sur les Broumalia à différentes époques : l’une, au VIe siècle, constituée par la Chronique de Jean Malalas (récit du livre VII consacré à la fondation de Rome et à la création de rites et cultes par Romulus), l’autre, au Xe siècle, constitué par le Livre des cérémonies de Constantin VII Porphyrogénète (chapitre 18 du tome II de l’édition de J.J. Reiske, consacré à la description de la cérémonie solennelle du broumalion impériale).
Episcopal activity in Late Antique Egypt: Theban bishops at work.
Renate Dekker, Université de Leyde
My research examines the social role of bishops in Late Antique Egypt, particularly in the Theban region (near modern Luxor), in a period that decisively shaped the history of the Coptic Orthodox Church and that of Egypt in general (ca. 600-641).
During this period, the doctrinal conflict over Christology at the Council of Chalcedon (451) became a definite schism, for the anti-Chalcedonian movement in Egypt rapidly developed into a separate church hierarchy alongside the official one, which was supported by the Byzantine state. This oppositional church is the forerunner of the present-day Coptic Orthodox Church. The beginning of the seventh century was also marked by political unrest, caused by the Persian invasion, the reconquest of Egypt under the Emperor Heraclius, and the oppressive religious policy by the Byzantine state.
Whereas the Chalcedonian bishops presumably resided in or near the cities, their anti-Chalcedonian counterparts mainly operated from monasteries in the countryside and seem to have formed a stabilizing factor in this dynamic society. Direct information about the anti-Chalcedonian church is provided by the professional archives of the bishops Abraham of Hermonthis and Pesynthios of Koptos, which are unique sources of factual information on episcopal activity, unlike the literary texts that we usually examine. By analyzing the specific nature of the contacts and social involvement of Abraham and Pesynthios on the basis of their archival documents, it will be possible to evaluate their role as social agents and to correct the idealized images of bishops as presented by normative texts.
Empire unitaire et contextes régionaux : Constantinople et les provinces dans les épistoliers du Xe et XIe siècle.
Luisa Andriollo, Université Paris – Sorbonne
Tout en gardant une structure ecclésiastique et d’État centralisée et une vocation universelle, l’empire byzantine fut toujours un empire multiethnique: à l’intérieur de ses frontières, qui s’étendaient au début du XIe siècle de l’Italie méridionale à la Syrie et au Caucase, on rencontre en fait des situations géographiques et culturelles très variées et des particularismes régionaux importants.
Mon projet de recherche, qui se déroule dans le cadre d’une cotutelle entre l’Université Paris IV et l’Université de Pise et sous la direction de J.-C. Cheynet, porte sur les relations entre Constantinople et les provinces et sur le rôle joué dans ce contexte par l’aristocratie, essentiellement micrasiatique : elle représente en fait entre IXe et XIe siècle le groupe social à travers lequel se réalise le lien entre pouvoir central et territoires périphériques.
Dans mon intervention je me propose d’illustrer cette gamme de relations telle qu’elle ressorte de la témoignage des textes épistolaires. En fait, parmi les sources à notre disposition les épistolaires du Xe et XIe siècle offrent un regard particulièrement intéressant sur les rapports entre les provinces et la capitale. D’un côté ils laissent paraître l’attitude de l’administration centrale et des milieux constantinopolitains à l’égard des territoires périphériques de l’empire, qui se balance entre préjugés, sentiment de supériorité et intérêt pour l’exploitation des ressources provinciales. Au même temps ils témoignent aussi des particularités régionaux, des faits et des problèmes locaux et de la perception du pouvoir central, représenté par l’empereur et ses fonctionnaires, par les gens qui vivaient en province ou qu’y avaient des intérêts.
Reconsidering Hagia Eirene through Ottoman Era Documents.
Bilge Ar, Université technique d’Istanbul
Hagia Eirene Church represents an important step in the formation of a unique Byzantine architectural style. It is one of the main stages proceeded with another Constantinople church Polyeuktos, reaching to the most explicit outcome; Hagia Sophia, for the efflorescence of the Early Byzantine architectural style. It comes forth in the city history as the most important church of the capital till the construction of Hagia Sophia. The church had been refunctioned and reused throughout the years it had been under Ottoman rule. It had been embraced by the outer walls of the newly built Topkapı Palace and had been transformed into an ammunition store short after 1453. Holy relics originally kept in the church and spoils of the conquering were housed here besides the weapons of the depot. It had then been expanded in 1726 and taking the name Daru’l-esleha (House of Weapons), having the valuable material in it reorganized into an observable collection. After being used as a house for the collection and an armory depot for many years it had been transformed into the first Imperial Museum (Muze-i Humayun) in 1869. The Ottoman history of the building has only been mentioned by important dates and major function changes in earlier sources. This paper aims to tell the story of this monument during Ottoman era handling all the applications for repairing and those realized due to function changes and the later additions. Besides the physical additions and applications the administration of the building, important figures, other establishments functioning together with it and construction activities within the built environment around it are also among the subjects handled. A retrospective evaluation of Ottoman and Byzantine history of the building may also help to answer unanswered questions of the Byzantine monuments through Ottoman era documents including documents from Ottoman archives, images from miniatures, gravures, photographs in the 19th century and travelers notes.
The post Byzantine temple of Saint Dimitrios in Monastiri.
Sofoklis Kotsopoulos, Université Aristote de Thessalonique
In this paper, a part of the doctoral research that I elaborate at the department of History of Architecture and Art (Faculty of Architecture, Polytechnic School, Aristotle University of Thessaloniki – Greece), is presented. The title of the PhD study is “The Architecture of the city of Monastiri and the whole area of Pelagonia”. Supervisor of the thesis is Prof. Maria Kampouri–Vamvoukou. The paper is presented in English.
The city of Monastiri (which nowadays belongs to FYROM), was based in Northwest Macedonia and during the 19th century was still subdued by the Ottoman Empire. Despite the hard political and national situation of Greece in this century, Greek community, which was characterized by its education, civilization and commerce, made this city the second most important centre of the North Greece, after Thessaloniki.
In 1830-1831, the Greek Christians built the largest church of the city. The permission for the construction was given by the authorities, through difficult procedures. The guilds and the Christians of the city, contributed in church’s construction, with money, stock and work. The role of the members of the Christian community was really important, considering the circumstances of that era.
Church’s dimensions are ~41×36 meters, and is a great sample of a three nave, wood-roofing basilica of the post-byzantine period. The inside roofing is a woody arch and the naves are separated by seven woody columns. The main church is surrounded by a gallery and on the second floor there is a women loft. There was also a Christian curt and hidden room for confession. The main construction by stone and bricks is typical for the period but the decoration from marble, woodcut, ivory, gold leaves reveal the power of the community. The woodcut temple and the icons depict the high level of Christian art during the 19th century in this area.
The scene of the communion of the Apostles on Syrian, Armenian and Coptic manuscripts.
Nikitas Passaris, Université d’Athènes
The subject of the Communion of the Apostles is based on the evangelic narration of the Last Supper. In this presentation, based on my PhD research, we will present scenes from Syrian, Armenian and Coptic manuscripts and compare them to the Liturgical Typikon, in order to determine to which extent the representation of the scene has been influenced by the differences of the Liturgical Typikon.
The older scenes with this subject date to the second half of the 6th century and come from the aerea of Syria. Two types dominate according to the representation of Christ. In the first one, Christ is represented once, as in the Raboula manuscript, whereas in the second, who is more common, Christ is represented twice behind the altar offering bread and wine to two Apostles. In these representations, contemporary practices of the Liturgy are depicted. The model for these scenes could be found in monumental painting and particularly in the Church of the Last Supper, on Mount Sion in Jerusalem, which we know of from written sources. In addition, the oldest scenes are represented on Coptic frescoes of the 7th and 8th century, in the sanctuary, confirming the hypothesis of a model in monumental art. Representations are rare in monumental art, and these scenes are indeed important for this matter as they are the only pre-iconoclastic representations. The scene is found in the Coptic manuscript Par.Nat.Copt.13, of the 12th cent., in which the Apostles are depicted in different movements. In the Syrian manuscripts Brit.Mus.add.1170 and Vat.Syr.559, beginning of the 13th cent., Christ is represented on a throne, whereas in the manuscript Deir Zafaran (mid 13th cent.), the Apostles are represented on two levels. The Communion of the Apostles has also been represented in four Armenian manuscripts of the 13th and 14th cent., in which one can find differences in the representation of the subject. Do these scenes represent the differences in the Liturgical Typika or are these differences simply due to the evolution of the consecrated type of the 6th century?
Les illustrations du Stichéraire GIM Muz. 3674 du XIIIe siècle.
Maria Grinberg, Université Lomonossov de Moscou
Le stichéraire est un type du livre liturgique qui contient les chants officiels suivant l’ordre de l’année religieuse, y compris les Menées, le Triodion, le Pentikostarion et l’Octoéchos. Peu de Stichéraires enluminés sont parvenus à nos jours. Parmi les exemples les plus remarquables on peut citer Koutloumousiou n° 412 et Sinai cod. 1216. Ces manuscrits furent brièvement examinés par Kurt Weitzmann dans son article « The Selection of Texts for Cyclic Illustration in Byzantine Manuscripts », dans Byzantine Books and Bookmen. Ces manuscrits furent datés du début du XIIIe siècle et leur origine fut localisée à la région palestinienne. Il est néanmoins plus probablement de voir apparaître les manuscrits enluminés de ce genre à partir du XIIIe siècle.
Le manuscrit coté GIM Muz.3674 est décoré avec vingt-cinq miniatures placées sur les pages sans encadrement, chaque d’eux étant précédé par le passage de texte qu’elle illustre. Les particularités paléographiques et stylistiques permettent de dater ce manuscrit vers le XIIIe siècle, mais la date précise reste à établir.
Mon intervention présentera une analyse iconographique des miniatures du Stichéraire. Il s’agit, notamment, d’identifier ses sources iconographiques et de spécifier les critères du choix des sujets, qui contribuent à enrichir le sens du texte. La plupart des miniatures, soit vingt-et-une est placée dans la partie des Menées, trois dans le Triodion et une dans le Pentikostarion. Cet ensemble est, en effet, un mélange des scènes de l’Evangile, des images des Fêtes et des représentations des saints. Ces dernières ne correspondent pas forcément au texte qui les suit. L’iconographie de cette partie du Stichéraire était fondée principalement sur les illustrations des Ménologes du XIe siècle mais, le choix du sujet reste original et réalisé en fonction du programme iconographique particulière du manuscrit.
L’espace liturgique en Bulgarie médiévale aux IVe-XIe siècles – Lieu de rencontre entre un art officiel et un art des fidèles.
Julia Reveret, Université de Clermont-Ferrand II
La Bulgarie médiévale (sous entendant pour notre étude la Bulgarie dans ses frontières actuelles et la Macédoine), pays aux frontières fluctuantes durant cette période est d’un grand intérêt par sa situation géographique de carrefour où depuis l’époque thrace se croisent et fusionnent différentes ethnies et civilisations. C’est un point de confluence et de rencontres entre les cultures des empires romains d’Occident et d’Orient, des ethnies venant du Nord, du monde méditerranéen et des régions d’Asie centrale. L’adoption et l’officialisation de la religion chrétienne en tant que religion d’état sous le règne de Boris-Michel Ier en 864 conduit à nous interroger sur les productions artistiques chrétiennes face à cet héritage multi-ethnique et multi-culturel, plus précisément sur les liens existant entre ces populations emprunts de traditions et de croyances et l’art chrétien officiel, tout en tentant de définir les rapports entretenus entre la construction de ce 1er royaume et la religion chrétienne. Par ailleurs, la proximité de ce territoire avec la capitale impériale, Constantinople présente un autre intérêt et suscite d’analyser le poids et le rôle de la puissance byzantine sur le développement et l’évolution de l’art chrétien produit sur ces terres balkaniques depuis l’installation d’Asparouch en 680 mais surtout lors de la prise de Preslav par les Byzantins en 1018. Cet art « bulgare » arrive-t-il en effet à s’émanciper, à créer sa propre personnalité en présence des deux aspects de la puissance byzantine : l’un fascinant à leur yeux, l’autre oppressant ? Et s’il y parvient comment le fait-il et avec quel degré d’indépendance stylistique ou technique par rapport à cet écrasant mentor ?
Les représentations de saints militaires dans les peintures murales du monastère d’apa Apollo de Baouit : les débuts d’une longue tradition.
Héléna Rochard, École pratique des Hautes Études
L’iconographie des saints militaires, bien connue dans l’art byzantin, s’est particulièrement développée au Moyen-Orient, et tout spécialement en Égypte, où la tradition s’est perpétuée durant plusieurs siècles et a même été revisitée au xviiie siècle. Les peintures de Baouit comptent parmi les plus anciens exemples du thème et offrent un nombre important d’images qui permettent d’observer quelques variations autour d’un type iconographique qui semble déjà bien établi.
La plupart de ces soldats connurent leur martyre à l’époque des grandes persécutions, au iiie et au ive siècle. Cette période de troubles constitua pour les Coptes l’origine de l’« Ère des Martyrs », calendrier débutant en 284, année de l’avènement de l’empereur Dioclétien. Ces saints guerriers, dont l’iconographie porte l’empreinte d’un héritage antique, occupent une place particulière au sein du répertoire hagiographique ; tantôt figurés à cheval, tantôt en pied ou en buste, ils incarnent les soldats du Christ et les victorieux défenseurs du christianisme.
Les représentations de martyrs illustres, comme Théodore, Mercure, George, Serge et Bacchus, de même que celles de saints égyptiens, témoignent de la diffusion, ou de l’émergence, de leur culte et attestent de la grande dévotion dont ils faisaient l’objet. L’étude approfondie des attributs et des inscriptions qui caractérisent les saints, conjuguée aux observations relatives à leur emplacement dans l’espace, permet d’aller plus loin sur la compréhension du rôle qu’ils jouent dans le programme iconographique de ces édifices monastiques.
Cette intervention s’inscrit en complément des études récentes menées sur les saints militaires dans l’art byzantin.
The built environment of the East Mediterranean from the fourth to the seventh centuries: the impact of Christianity.
Morgan Dirodi, St Cross College, Université d’Oxford
The cities of the eastern Mediterranean were lively centres of urban life and monumentality. The rescript of Milan gave Christianity a major role within Roman society and allowed it the possibility to intervene in the urban landscape. Thus the rise of Christianity as a major social and political actor led to it shaping the city and it having to adapt to the city itself.
To better understand the way in which the urban landscape and monumental Christianity interacted I am proceeding to analyse a number of cities in the Levant to develop a clear understanding of the chronology of the rise of monumental Christianity and its influence on the topography of these cities. I am proceeding in two mains steps: firstly I am constructing a (partial) gazetteer of the main cities of the Levant, of their Christian building activities and their Late Antique urban contexts. My aim in this first part is to lay out in one single corpus all the necessary information that an analysis of such a procedure requires, to enable me to examine the development of the region in a transversal manner rather than the fragmented picture that is currently offered by the large number of discreet publications that is currently available. Secondly I intend to analyse the data that I have collected in order to identify the main trends that are involved in the Christianisation of the region. As a result of my initial data collection I have, so far, identified two major trends that I will discuss in the paper: on the one hand there is pragmatism: due to the complex urban environment of the Levant, Christians were forced to be pragmatic in the size scale and scope of their buildings, adapting the plans and locations of Churches to the urban context. The second trend is a opposition between monumental and topographic priorities: when locations had to be chosen very often the choice was between the best location (topography) and the location that allowed the best monumental development (monumentality), the choice of where church complexes were built ( in particular cathedrals) and their size and scope is thus of particular importance.
L’urbanisme médiéval de la ville de Zadar à l’époque du pouvoir byzantin en Dalmatie.
Iva Rukavina, Université Paris Ouest – Nanterre La Défense
L’objectif de cette présentation, dont le contenu est issu de nos recherches dans le cadre de notre thèse, est de montrer les relations entre l’Empire Byzantin et la ville de Zadar à l’époque médiévale, notamment à travers les modifications urbaines qu’a subies la ville à cette période historique.
Zadar est située sur la côte adriatique orientale en Croatie. Le noyau historique de la ville actuelle est situé sur la petite presqu’île qui ferme la baie dans laquelle se trouve le port. Les vestiges archéologiques les plus anciens datent du IXe siècle av. J.C. Pendant la période romaine, Zadar (Iadera) a été l’un des centres les plus importants de la côte adriatique orientale. La ville antique a été conçue suivant les schémas romains, ce qu’atteste le réseau orthogonal de voies toujours conservé.
Le pouvoir byzantin instauré à la fin de l’époque de l’Antiquité tardive caractérisera l’époque médiévale jusqu’au début du XIIe siècle, période pendant laquelle Zadar occupera une position particulière au sein de la Dalmatie. Peu affectée par les invasions barbares, la ville gardera son aspect urbain pendant l’époque médiévale et sera dotée de nombreux bâtiments nouveaux, à caractère sacré en particulier.
La description de Zadar datant du milieu du Xe siècle et attribuée à l’empereur byzantin Constantin VII Porphyrogénète, dans le chapitre 29 de son ouvrage De Administrando Imperio, constitue une des sources les plus importantes pour connaître l’urbanisme médiéval de la ville de Zadar.
Saint Siméon le Jeune: contextualiser l’édification d’un sanctuaire au VIe s.
Ayse Belgin-Henry, Université d’Illinois – Urbana Champaign
Le centre de pèlerinage et monastère de Saint Siméon le Jeune est situé à proximité de la ville d’Antioche (moderne Hatay/Turquie). Le complexe, qui fut construit du vivant du Saint, subit de nombreuses transformations au cours des Xe-XIe s. et resta actif jusque dans le courant du XIIIe s. Le site fut fouillé par Mécérian et Djobadze, respectivement dans les années 1930 et 1960, qui en révélèrent les caractéristiques principales. Ce travail pionnier nécessitait cependant d’être complété par une étude détaillée du bâti. A cette fin, j’ai mené trois campagnes de prospection, en 2007-2009, afin d’étudier et de documenter l’architecture du complexe dans le cadre d’une thèse de doctorat intitulée “The Pilgrimage Center of St. Symeon the Younger: Designed by angels, supervised by a saint, constructed by pilgrims”.
Cette contribution se concentrera sur la période du 6e s., au cours de laquelle on peut remarquer au moins deux phases de construction distinctes. Nous aborderons particulièrement le contexte architectural, en fonction des nouveaux résultats issus du travail de terrain. Nous chercherons notamment à contextualiser les constructions du 6e s. dans le cadre de l’histoire régionale d’Antioche.
Khirbet el-Libneh: un ensemble de vestiges protobyzantins.
Anna Chok, Université de Provence
Le présent travail fait partie d’une thèse en Archéologie en cinquième et dernière année de préparation, sous la direction de Monsieur Marc GRIESHEIMER au Centre Camille Jullian (Université de Provence). En 1997, un site archéologique, d’une superficie d’environ 11400 m², faisant partie de ce qu’on appelle « Khirbet el-Libneh » a été découvert dans la zone industrielle de Tartous (une ville sur la côte syrienne). Depuis, sept chantiers de fouilles, organisés par la Direction Générale de l’Antiquité et des Musées, ont mis au jour une partie de ce site qui compte, parmi ses éléments les plus importants, une grande basilique avec une mosaïque géométrique, une citerne avec un système de canalisation et une trentaine de salles de tailles différentes. Ces dernières contiennent également des bassins, des éléments de plusieurs pressoirs et des fours. Les vestiges d’un mur, d’une épaisseur importante, qui se prolongent sur une centaine de mètres à l’est du site pourraient faire partie d’un mur d’enceinte.