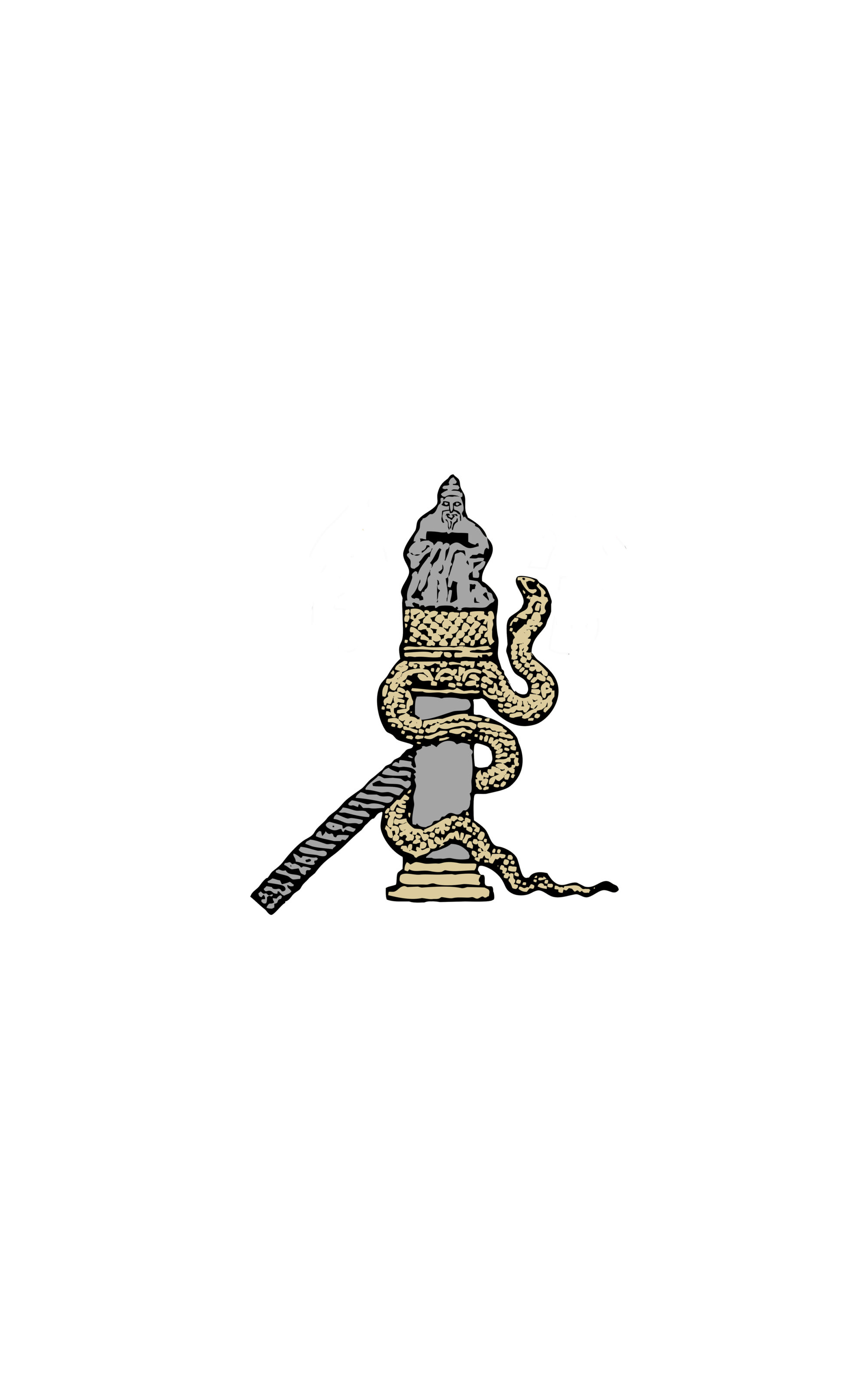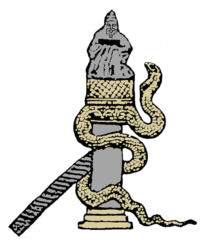RÉSUMÉS DE COMMUNICATIONS DES PARTICIPANTS
AUX RENCONTRES BYZANTINES 2012
(dans l’ordre du programme)
Les résumés ont été corrigés par les auteurs eux-mêmes.
Salle Walter Benjamin
10h00, Vendredi 19 octobre 2012
The Byzantine Revival and the “Oriental” Synagogue
Fani Gargova, Université de Vienne.
It is commonly known that Byzantine elements were widely used from the early 1840s up to the 1940s in the search for an architectural language to represent Jewish identity; yet art historical scholarship has dealt surprisingly little with this fact. A thorough analysis of the origins of these “rediscovered” architectural elements, the means of employment, and the symbolic meaning of these references in the context of synagogue architecture and the Jewish community is still missing.
The fashion to build in the Neo-Byzantine style started at a time, when historicism flourished, but its use endured in ways unlike the majority of tendencies of the 19th and 20th centuries by coming also into symbiosis with the Avant-Gardes and transforming its formal vocabulary to fit the needs of modernization. An example of this process is the extensive and conscious use of precious material such as gold or marble, as well as a certain renaissance of the dome.
Nevertheless the Byzantine revival in Jewish architecture was a rather Western phenomenon. It was marked by the common Western fascination and occupation of the “Orient”. The nascent identification of the Jewish community with this geographical region met with the need to express their “Otherness”. Thus it is necessary to ask to what extent patrons and viewers were aware of visual Byzantine influences and to further investigate the (mis-) understanding of its formal vocabulary.
This paper will seek to examine the modes of application of Byzantine elements and the reasons for its continuous use among synagogues built during the 19th and 20th centuries. It will draw attention to the problem of appropriating the “Orient” and exemplify it on the basis of synagogue architecture from Western and Eastern Europe and the United States.
Salle Walter Benjamin
10h30, Vendredi 19 octobre 2012
Le programme hagiographique de Saint-Marc de Venise : au confluent de l’Orient et de l’Occident
Influences orientales ou occidentales
Élodie Guilhem, École pratique des hautes études.
La basilique Saint-Marc, chapelle palatine des doges de Venise, a été reconstruite à la fin Xe siècle, afin de remplacer l’ancienne chapelle ducale dédiée à saint Théodore qui possédait elle-même un petit sanctuaire consacré à l’évangéliste Marc, dont les reliques étaient nouvellement arrivées.
Cette chapelle se veut d’inspiration byzantine tant sur le plan architectural que sur le plan du programme hagiographique selon un schéma consacré. Cette basilique inspirée d’un modèle impérial ancien (l’Apostélion) était conçue comme un immense reliquaire, miroir de la splendeur de la Sérénissime.
Le culte des saints et leur représentation occupe donc une place centrale, qui à ce jour n’a fait l’objet d’aucune étude. Cette communication a permis de dresser un aperçu rapide des saints de Saint-Marc. La basilique regroupe des cycles hagiographiques et des représentations de saints isolés. Ce programme a connu de nombreuses évolutions au fil des siècles.
Dans la première phase de la construction, des saints assez fréquents et d’inspiration byzantine sont représentés, comme les saints ermites : saint Paul ermite, et des saints stylites : saint Siméon.
Le programme de la basilique subit des ajouts postérieurs souvent dans des places laissées probablement vides (en effet un interdit du grand conseil de 1265 interdisait le changement de toute figure ou représentation), ainsi apparurent de nouveaux saints tels saint Bernard de Sienne. Ces ajouts, comme l’indiquent ces figures, étaient liés à l’apparition de nouveaux saints célèbres et plutôt d’influence occidentale. Ces apports peuvent aussi être dus à l’acquisition de nouvelles reliques par la République, c’est le cas de la construction de la chapelle dédiée à saint Isidore dont les reliques furent acquises en 1125, ou encore de saints locaux qui correspondent aux nouveaux territoires conquis sur la terraferma, avec le bienheureux Antoine de Brescia.
Le programme subira encore des modifications après l’époque médiévale, en raison des nombreuses restaurations modernes. Il est important de déterminer si nous sommes en présence de nouveaux saints ou si certains saints ont été refaits dans un style plus actuel et ont remplacé leur figure antérieure, c’est le cas probablement pour saint Paul ermite, son culte étant peu en faveur à la Renaissance
Ce rapide aperçu, nous a permis de mettre en avant le lien étroit qui unit programme iconographique, liturgie, spatialité, politique en alliant savamment Orient et Occident avec pour objectif d’être le symbole du pouvoir vénitien.
Salle Walter Benjamin
11h00, Vendredi 19 octobre 2012
Autour de la « production artistique de Kastoria » :
les monuments peints de la fin du XVème siècle
Rémi Terryn, École pratique des hautes études.
Le but de cette communication était de mettre en lumière un groupe d’églises peintes à la fin du XVème siècle en présentant leurs particularités iconographiques et stylistiques communes à partir de monuments dignes d’intérêt : l’Ancien Catholicon de la Transfiguration des Météores, l’église Saint-Nikita de Čučer, les monastères de Treskavac, de Poganovo et de Kremikovtsi.
Ces églises sont l’œuvre de peintres itinérants anonymes originaires de Kastoria, centre artistique majeur qui jouissait d’un statut particulier, parce que situé sur la via Egnatia où le commerce battait son plein. A la fin du XVème siècle, à une époque de domination ottomane (Turcocratie), la place économique stratégique de la ville prédestina au développement presque sans interruption d’une vie artistique assez intense : le terme de la vie culturelle ne fut pas complètement affecté et on assista à un renouveau d’activité manifesté par des édifices de culte richement décorés. Les équipes de zographes qui gravitaient autour de Kastoria comptaient parmi elles, vraisemblablement, des artistes très convoités, puisque leurs œuvres se retrouvent dans de petites localités telles qu’Aiginio et Koustohori en Grèce, à F.Y.R.O.M., en Bulgarie, et, indirectement, jusqu’en Moldavie.
Le rattachement d’une œuvre à cette production artistique se fait en fonction du style des peintures et de l’iconographie. Dans l’état actuel de nos connaissances et en nous appuyant sur les travaux antérieurs (d’Andreas Xyngopoulos à Cveta Valeva), il faudrait tenir compte de deux choses : des traditions de la peinture Paléologue du XIVème siècle d’une part, et, d’autre part, de l’ouverture des artistes aux influences occidentales dont témoigne le recours aux traits réalistes et naturalistes puisés dans la peinture italienne du gothique tardif. Combinés à la présence de thèmes iconographiques rares – ex. de la Déisis élargie, du motif du buste d’Adam sous la Croix dans la scène de Crucifixion – ces traits nous obligent à y voir la marque d’un atelier, au puissant souffle créateur et garant de l’oikoumene orthodoxe.
Salle Walter Benjamin
12h00, Vendredi 19 octobre 2012
La broderie dans l’Égypte antique, de l’époque romaine à l’époque arabe. Étude technique et iconographique. Influences, échanges et diffusion au sein du bassin méditerranéen
Amandine Mérat, École du Louvre.
Parmi les témoignages archéologiques retrouvés sur le territoire égyptien, les textiles constituent une source précieuse d’informations, et sont à nouveau placés, depuis plusieurs années, au cœur des considérations scientifiques, comme en attestent les nombreuses associations et journées d’études françaises et internationales qui leur sont consacrées. Si certaines techniques, telles que la tapisserie, ont d’ors et déjà été abondamment étudiées, d’autres en revanche sont toujours mal connues, à l’image de la broderie, sur laquelle les publications et les recherches menées restent encore, à ce jour, rares et ponctuelles. De tels constats mettaient naturellement en évidence l’importance et la nécessité de réaliser une étude globale et approfondie sur ce sujet, auquel j’ai choisi de consacrer ma thèse, engagée depuis fin 2010, dans le cadre d’un Troisième Cycle à l’École du Louvre.
Cette présentation de mon sujet de doctorat, faite lors des Ves Rencontres internationales des doctorants en études byzantines, a été pour moi l’occasion d’exposer les enjeux et les objectifs aussi divers que variés de cette thèse (reconstitution d’une histoire technique, sociale, économique et culturelle de la broderie égyptienne antique ; repositionnement de l’Égypte vis-à-vis des autres cultures du Proche-Orient et du Bassin Méditerranéen dans la production de broderies durant l’Antiquité ; réalisation d’un catalogue raisonné des broderies égyptiennes antiques connues à ce jour, ainsi que d’une base de données informatique, …), ainsi que la démarche de recherche mise en œuvre afin de mener ce projet à bien (études techniques et iconographiques réalisées sur les pièces conservées dans les grandes institutions françaises et européennes ; tableaux et base de données recensant les broderies répertoriées et/ou étudiées ; bibliographie, …).
Salle Walter Benjamin
12h30, Vendredi 19 octobre 2012
Rayonnement de Byzance : le costume royal en Nubie (Xe-XIe s.)
Magdalena Wozniak, Université Paris IV-Sorbonne.
Dans un ouvrage éponyme publié en 2006, Tania Velmans a démontré l’appartenance de la Nubie à l’aire d’influence byzantine, même si cette région « se distingue par un langage plastique à part ». Une démonstration qui n’est somme toute pas surprenante au regard du rôle joué par Byzance dans l’évangélisation de la Nubie au VIe s.
La présente communication a pour objet d’étude le costume royal à travers le portrait de Zacharias III (moitié du Xe s.) et deux portraits de son successeur, Georgios III (fin Xe s.). Dans l’ensemble, les deux souverains portent un costume inspiré de la mode byzantine, composé de robes superposées, recouvertes d’un manteau attaché sur l’épaule droite. Cependant, l’observation plus détaillée des peintures démontre le caractère plus « archaïque » du portrait de Zacharias III dont les vêtements semblent se référer davantage à la mode byzantine des VIe –VIIe s.
L’analyse des attributs royaux, en particulier la couronne, apporte également des conclusions inattendues : à contre-courant de l’idée généralement acceptée d’une imitation de l’iconographie impériale byzantine par la monarchie nubienne, il apparaît que la couronne portée par le roi à la fin du Xe s. n’a pas le caractère impérial qu’on lui attribuait jusqu’ici. L’étude de la titulature royale confirme également les limites de l’influence byzantine en Nubie et invite à reconsidérer non seulement la nature des relations entre les deux entités mais également les limites chronologiques de ces contacts.
Salle Walter Benjamin
14h30, Vendredi 19 octobre 2012
Un lot de céramiques du VIIe siècle à Halabiya (Syrie)
Nairusz HAIDAR VELA, Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
Les niveaux de transition byzantino-omeyyade demeurent mal connus en Syrie, en dépit de l’importance qu’ils revêtent pour la compréhension des sites. Longtemps à tort, les chercheurs ont considéré que la majorité des villes et villages connaissaient leur occupation interrompue à la fin de l’époque byzantine. Néanmoins, depuis quelques décennies, les fouilles stratigraphiques ont permis d’attester une continuité de l’occupation de la période byzantine à l’époque islamique sur de nombreux sites en Syrie du Nord. L’absence de nouvelles constructions ne traduit plus nécessairement un abandon et la transition byzantino-omeyyade est mieux appréciée, ce qui a permis de porter un nouveau regard sur cette période.
Dans le domaine de la céramologie, nous sommes toutefois, encore aujourd’hui, confrontés à un manque de publications issues de sites ayant une occupation continue de l’époque byzantine à l’époque islamique. Le passage de la céramique byzantine à la céramique omeyyade n’est donc pas toujours facile à percevoir dans cette région où les productions, tout en restant tributaires des caractéristiques locales, s’imprègnent d’influences extérieures. Loin de rompre totalement avec la tradition de l’Antiquité classique, la céramique du VIIe s. est empreinte de caractéristiques propres à l’époque protobyzantine auxquelles se mêlent de nouvelles propriétés qui se développeront tout au long des premiers temps de l’Islam ; le matériel issu des fouilles de Halabiya, sur l’Euphrate, constitue un témoignage explicite de ce phénomène.
À travers le matériel issu d’un secteur d’habitat de Halabiya, exceptionnel par son état de conservation, cette présentation dressera un panorama des poteries en usage durant la phase de transition byzantino-omeyyade. De nombreux contextes liés à cette occupation ont été mis au jour, livrant des poteries de tradition byzantine associées à de nouvelles formes désormais caractéristiques des répertoires arabo-musulmans. Nous nous attacherons donc à présenter les caractéristiques héritées des productions protobyzantines ainsi que les « influences » proprement islamiques.
Salle Walter Benjamin
15h00, Vendredi 19 octobre 2012
Reassessing the past: the case of the Late Antique and Early Islamic period of Palmyra (AD 273-750)
Emanuele Ettore Intagliata, Université d’Edimbourg.
Palmyra (Syria) experienced a particular prosperity as a “caravan city” until the second half of the third century AD, when the events following the attempt at usurpation by Zenobia led to its economic collapse. For years these events have been considered as the starting point of an inexorable decline for the city.
My PhD research aims to reassess the Late Antique and Umayyad periods of Palmyra by analyzing three main distinct topics: urbanism, housing and pottery.
The delicate phase of transition between the classical and the Umayyad city has been hotly debated and is now considered as an indigenous and positive process started well before the Arab conquest. This transformation is characterized by numerous urban phenomena affecting enormously the overall aspect of the city.
Among these, the way of how and where people lived will be the subject of a more indepth study. The need for a living space brought the inhabitants of Palmyra to occupy existing public places and modify ancient roman houses. Crossing the published data with those coming from the recent excavations of the “Peristyle Building” carried out by the Italian-Syrian joint mission Pal.M.A.I.S., will allow to shed light on this topic.
Moreover, the study of a particular kind of common ware (“White Ware”) found during the excavation of the same building will allow to start a systematic analysis of the “post- 273” ceramic material.
By looking at these topics the research aims to demonstrate the longevity of Palmyra even after the “destruction” of the city by Aurelianus’ army, and to consider these ages as periods of deep changes rather than decline.
Salle Walter Benjamin
16h00, Vendredi 19 octobre 2012
Le travail des matières dures animales au Proche-Orient protobyzantin :
Nouvelles perspectives
Bénédicte Khan, Université Paris I Panthéon-Sorbonne
L’artisanat de l’os, de l’ivoire et de la corne pour la période byzantine est mal connu au Proche-Orient, par manque d’intérêt des chercheurs pour ces matières parfois considérées comme peu nobles (à l’exception de l’ivoire), étant principalement utilisées pour fabriquer des objets « simples », de peu de valeur. Néanmoins, la variété des productions indique un usage quasi journalier de ces matières dans de nombreux domaines de la vie domestique ou artisanale, et la facture exceptionnelle de certaines pièces démontre l’existence d’un artisanat spécialisé et de qualité. Les pièces produites dans ces matières sont donc d’une grande importance quant à la compréhension du quotidien des byzantins.
L’industrie liée a elle aussi été quelque peu négligée par la recherche ; or, les ébauches, supports, et rebuts de fabrication issus de cet artisanat sont une source inestimable d’informations quant au savoir-faire des artisans, à travers la reconnaissance des techniques mises en place dans la production d’un objet et l’établissement de leur chronologie permettant le remontage des différentes étapes de la chaîne opératoire. D’autres données peuvent également être récoltées grâce à l’étude de ces rejets d’ateliers, concernant notamment les matières utilisées (espèces animales, parties anatomiques préférées), les relations des artisans avec d’autres métiers (la boucherie pour l’approvisionnement en matières premières, la métallurgie ou encore l’ébénisterie, les matières osseuses étant utilisées dans la fabrication de manches de couteau et/ou d’éléments de marqueterie), etc.
C’est par une étude technologique que ces matières sont abordées dans cet exposé (et dans notre thèse), car la richesse des informations qu’elle apporte ouvre un pan entier de la société byzantine jusque-là peu exploré.
Salle Walter Benjamin
16h30, Vendredi 19 octobre 2012
La culture matérielle de la transition copto-byzantino-islamique en Égypte, du VIIe au IXe siècle.
Julie Marchand, Université de Poitiers.
Le titre exact de la thèse en préparation est « Recherches sur les phénomènes de transition de Égypte copto-byzantine à l’Égypte islamique. La culture matérielle ». L’enjeu de cette recherche est de cibler la culture matérielle, grâce aux objets issus de fouilles anciennes et récentes, afin de mieux interpréter une époque jusqu’ici encore appelée de « transition », fort méconnue, souvent moins bien appréhendée lors des fouilles archéologiques.
L’étude de la culture matérielle permet de visualiser les objets du quotidien qui sont de bons indicateurs des changements politiques qui ont eu lieu en Égypte. Ils contribuent à déterminer quels ont été les héritages byzantins ou coptes sauvegardés, et quelles ont été les nouveautés apportées par les conquérants.
La problématique du sujet est donc d’expliquer les différents types de mobiliers, de déterminer quels sont leurs héritages exacts, et par quelles transformations, les objets deviennent-ils ceux que l’on attribue à l’époque islamique. Nous pourrons ainsi avancer les critères qui définissent les attributions culturelles (technique, iconographie, usage, fonction) lorsque cela sera possible, et s’il est utile d’en donner une. L’occasion est aussi donnée de faire un point sur le terme de « transition », de le définir au mieux, notamment par ses dates. Une telle étude sera aussi l’occasion de remettre le changement de religion du pouvoir en place dans un contexte domestique.
Enfin, nous pourrons présenter quelques objets caractéristiques de la période de divers matériaux, notamment de la vaisselle céramique, à travers les siècles qui nous intéressent. Quelques sites archéologiques de référence seront présentés et constitueront un support contextuel.
Salle Walter Benjamin
10h00, Samedi 20 octobre 2012
Quelques réflexions sur le « Βίος τοῦ ἁγίου Ἱωάννου βασιλέως τοῦ Ἑλεήμονος ».
Lorenzo Ciolfi, École des haute études en sciences sociales.
A l’époque de la quatrième croisade, le 12 avril 1204, les troupes étrangères, arrivées jusqu’au Bosphore l’année précédente sous le prétexte de soutenir le souverain légitime Alexis IV, entrent dans Constantinople après un court siège et s’emparent de la ville. Dans le même temps, l’empereur des Romaioi, Alexis V, s’enfuit précipitamment. Des jours terribles s’ensuivent pour la population de la ville impériale, en proie au pillage, à la profanation, à la violence et au carnage.
Le 16 mai, Baudouin de Flandres monte sur le trône de Constantin. Une nouvelle ère s’ouvre pour Byzance : elle se caractérise par des forces centrifuges et par une crise de l’idéal universel. L’ancienne unité bien consolidée de l’Empire byzantin se fragmente en un système aussi compliqué que varié de principautés féodales sur le modèle occidental et de nouveaux états dans lesquels se préserve, en une sorte de continuum, la civilisation byzantine : le Despotat d’Epire avec les Angeloi, l’Empire de Trébizonde avec les Grands Comnènes et l’Empire de Nicée avec Théodore I Lascaris.
Pendant ces années si difficiles Jean III Vatatzès, empereur de Nicée (1222-1254), fut sans aucun doute un personnage clé pour la reconquête de Constantinople : il était l’initiateur de réformes importantes sur le plan économique et sur celui de la structure de l’état; il mena d’importantes campagnes militaires et intensifia une activité diplomatique habile principalement envers le Pape et Frédéric II. En raison de ses réformes et de ses nombreuses œuvres de générosité envers les plus pauvres, il fut bientôt reconnu saint et son culte a été célébré jusqu’au début du siècle dernier. Quelques compositions encomiastiques et une Vie lui ont été consacré.
Afin de mieux retracer la figure de Jean III et de comprendre l’influence qu’il aura sur les deux derniers siècles de l’ère byzantine, il est important de redécouvrir et d’analyser le Βίος τοῦ ἁγίου Ἰωάννου βασιλέως τοῦ Ἑλεήμονος, dont une nouvelle édition critique avec traduction et commentaire fait l’objet de mes recherches actuelles.
Dans la présentation que je propose, je contextualiserai les questions plus importantes liées à cet ouvrage (en particulier la tradition manuscrite, l’autorialité et la typologie textuelle) et j’offrirai à la discussion les premiers résultats de mon travail.
Salle Walter Benjamin
10h30, Samedi 20 octobre 2012
Le déchirement interne de la Serbie au XIVe siècle : une opportunité pour l’Église de Byzance ?
Jonel Hedjan, Université de Paris IV-Sorbonne.
L’influence byzantine sur le développement politique et culturel des Slaves du Sud est bien connue. À partir du IXe siècle, l’organisation étatique et ecclésiastique de ces peuples, de même que leur culture (spirituelle et matérielle), portent des marques directement héritées de Byzance.
Cette présentation a pour but d’analyser, à la veille des conquêtes turques au XIVe siècle, les divers aspects des relations ecclésiastiques de Byzance avec son État voisin slave, la Serbie. Chronologiquement, nous avons choisi les années qui vont de 1346 à 1402. Elles correspondent à l’élévation unilatérale du Patriarcat de l’Église serbe, suivie de la proclamation d’Étienne Dušan comme „Tsar des Serbes et des Grecs“, jusqu’à la proclamation par l’empereur byzantin, après la bataille d’Angora, d’Étienne Lazarević comme despote des pays serbes. Durant cette période, de multiples changements politiques se sont produits et ont provoqué des transformations dans la vie de l’Église et de manière plus générale dans celle de l’État.
Les principales questions auxquelles cette présentation tentera de répondre sont donc les suivantes : quels furent, à la veille de la conquête turque, les enjeux des relations entre Byzance et la Serbie sur un plan religieux ? Comment ces enjeux ont-ils transformé la politique de Byzance au sein des Balkans ?
Salle Walter Benjamin
11h00, Samedi 20 octobre 2012
L’Ancienne ou la Nouvelle Rome ? Les monastères grecs sous domination latine face à l’autorité universelle (XIIIe-XVe siècle)
Ludivine Voisin, Université de Rouen.
La quatrième croisade fait basculer une majorité de Grecs dans la juridiction romaine et réalise, de fait, l’union des Églises d’Orient et d’Occident telle qu’elle est conçue par l’Église de Rome. La papauté, le patriarcat et l’Empire multiplient pourtant pendant deux siècles les efforts pour parvenir à une union acceptable par les deux camps, preuve du décalage entre une union fantasmée et une réalité plus complexe. La question du ralliement des Grecs, et en particulier des moines, à l’Église universelle dirigée par le pape a fait l’objet de nombreuses parutions d’historiens et de théologiens, nourris d’une littérature essentiellement constantinopolitaine qui alterne sincère ralliement et littérature de controverse. Le positionnement des moines grecs coupés du patriarcat mais fidèles à l’orthodoxie tout en étant intégrés à l’obédience romaine n’a pas encore été pris en compte du fait, sans doute, d’une documentation lacunaire et essentiellement établie par la chancellerie pontificale. Bien que fragmentaires, les témoignages de l’attitude des moines grecs face aux deux autorités revendiquées comme universelles – papauté et patriarcat, s’ils sont remis en contexte, doivent permettre de mettre en évidence la situation singulière des monastères grecs situés en territoires gréco-latins dans le conflit qui absorbe leurs frères de rite situés de l’autre côté de la frontière juridictionnelle. Cet exposé libre en français, dont l’objectif est de proposer des éléments de réflexion sur la question de l’identité monastique grecque à la fin du Moyen-Âge, s’inscrit dans nos travaux de recherches doctorales portant sur les monastères grecs sous domination latine, menés sous la direction du Professeur Gilles Grivaud de l’Université de Rouen.
Salle Walter Benjamin
12h00, Samedi 20 octobre 2012
Les Grecs au service de la Porte ottomane dans la 2ème moitié du XVe siècle
Anna Calia, Université de Saint-Marin / École pratique des hautes études.
La diaspora des élites byzantines après la chute de Constantinople en 1453 a été étudiée depuis longtemps, surtout en ce qui concerne sa relation avec la floraison de l’Humanisme et des études grecques en Occident. Pendant les dernières années de nombreuses études ont exploré le rôle joué par le Patriarcat œcuménique ainsi que par les aristocrates et les marchands grecs dans la transition byzantine-ottomane à Constantinople. Les ottomanistes ont aussi montré la centralité des convertis ou renégats issus des familles de l’élite byzantine dans le fonctionnement de l’administration et dans la construction de l’image impériale ottomane.
Encore peu connue est par contre la sort des Byzantins qui restèrent au service du sultan à Constantinople en tant que secrétaires, interprètes, chanceliers, copistes. Ils sont d’ailleurs attestés aussi dans plusieurs documents d’archives occidentales, étant donné que jusqu’à la fin du XVème siècle la chancellerie ottomane utilisait le grec dans les échanges avec les puissances occidentales et le medio-serbe avec Raguse et la Hongrie.
Sous le règne de Mehmed II la présence des certains Byzantines dans la chancellerie ottomane était liée aussi aux intérêts littéraires du sultan. Parmi les autres figures, ressort celle de Jean Dokeianos, personnage emblématique de la transition byzantine-ottomane. Auteur de nombreuses compositions d’occasion pour Constantin XI et d’autres membres de la cour paléologue de Mistra, copiste et possesseur d’une bibliothèque remarquable, après la conquête ottomane du Péloponnèse en 1460 il préfère « le turban du sultan à la mitre romaine » devenant secrétaire et copiste de manuscrits – soit littéraires soit d’enseignement – dans le Palais ottoman. Au même temps il enseigne dans le Patriarcat tout en restant chrétien et anti-unioniste.
Ses œuvres, qui comprennent des épîtres, éloges et oraisons, n’ont été publié que partiellement par Spyridon Lambros. Elles par contre nous donnent un aperçu du très vif débat intellectuel qui animait la cour paléologue à propos de l’éducation des souverains, de l’importance des modèles classiques, du destin de l’empire et de l’identité ethnique du despotat de Mistra à la première moitié du XVème siècle.
Salle Walter Benjamin
12h30, Samedi 20 octobre 2012
Les sorciers à Byzance aux XIe et XIIe siècles : des professions de foi aux « lynchages » politiques
Jean-Cyril Jouette, Université de Provence Aix-Marseille
Si l’on en croit les propos de l’hagiographe Grégoire le Cellérier, il n’était pas rare de croiser des sorciers offrant leurs services dans la société byzantine du XIe siècle. À la lecture des annales de Nicétas Choniatès, nous pouvons faire le même constat pour le XIIe siècle. La plupart du temps, les sources de cette époque s’accordent à dire que ces sorciers embrassaient intentionnellement les « pouvoirs des ténèbres » pour arriver à leurs fins : nous verrons donc dans un premier temps les motivations de ces sorciers, le mode opératoire employé, les réussites des sortilèges et encore les conséquences de leurs actes selon l’orthodoxie. Puis dans un second temps, nous verrons comment l’accusation de sorcellerie eut un usage plus politique : à partir d’une confrontation des sources, donnant parfois des explications divergentes autour d’une affaire par exemple, nous nous concentrerons sur l’efficacité d’une telle accusation et les conséquences sociales et politiques qu’entraînait un tel jugement.
Salle Walter Benjamin
13h00, Samedi 20 octobre 2012
The aenigmatic scribe Ioannikios (XIIth C.) revisited
Ilias Nesseris, Université de Ioannina.
THE EXISTENCE OF A HOSPITABLE ENVIRONMENT is without doubt one of the staple prerequisites for the sustenance and development of any kind of intellectual activities. Constantinople in the twelfth century, esp. during the Comnenian era, did indeed provide such a suitable background, which facilitated the prosperity of education. This is very well demonstrated by the operation of many schools of elementary and higher education, the teaching activities of many distinguished scholars (such as Theodore Prodromus or Eustathius of Thessalonica) and the existence of literary theatra. This rich milieu of the capital enabled and provided a vivid market for the copying and circulation of books, and therefore a number of individual scribes as well as scriptoria are attested. In fact, one of the most prolific scriptoria of this period was the one directed by the monk Ioannikios. Although he was initially placed in the fourteenth century by A.M. Bandini –a view later followed by others– it was aptly proven by Nigel G. Wilson on the basis of palaeographical grounds that Ioannikios was to be dated two centuries earlier. More than twenty-five manuscripts come from his scriptorium, most of them in fact from his own hand, and the number keeps rising in the last years, as more and more codices have been ascribed to him. What is very interesting is that the content of these manuscripts is mainly secular (Homer and the tragics, though Aristotle and Galen are predominant). Modern research has mainly focused on the copying activities of Ioannikios, while not so many aspects of his aenigmatic figure have been yet fully explored. With the present paper we aspire to bring forth more concrete evidence about his work and his identity.
Salle Walter Benjamin
14h30, Samedi 20 octobre 2012
Capitis deminutio : Exile, banishment and punishments to ambassadors during Justinian’s era
Aitor Fernández Delgado, Université de Alcalá de Henares.
The Sixth century, recently defined by Michael Maas as «Justinian’s era», is a key moment to understand the characteristic features of the Early Byzantine world. It is also a time in which the convulsive political circumstances promote a deep redefinition of the diplomatic activity, along with a significant increase of its volume, becoming so one of the main tools of the State regarding to his «foreign policy». Thereby, along this paper I pretend, within the framework of my doctoral thesis, about the «long sixth century» diplomacy and its implications and as part of the research project «Exiliados y desterrados en el Mediterráneo (siglos IV-VII) -HUM 2011/22631-»; to consider one of the hardest punishments of this historical context, from a diplomatic perspective: the exile or interdictio aquae et igni. First of all, I will depict the general scene of the Late Antique Roman diplomacy along this «long sixth century (491-630)», focusing on the main characters for its proper performance: the envoys. Considering them profile, juridical status and main pursuing goals, I will observe if they were susceptible of being punished or not because a diplomatic failure or because another reasons. If so, relying on the evidences provided by the written sources of the period, I will note the reasons why they were punished and the end of such penalties; considering, of course, the kind of punishments of which they could be object. Finally, and after having defined what is considered as exile and banishment, I will notice if among that possible kind of punishments it was applicable or not to the diplomatic corps.
Salle Walter Benjamin
15h00, Samedi 20 octobre 2012
Interpréter le De Signis de Nicétas Chôniatès, ou : le mirage de l’historien
Stanislas Kuttner-Homs, Université de Caen Basse-Normandie.
Dans l’œuvre de Nicétas Chôniatès, historien et orateur des XIIe-XIIIe siècles, le De signis, opuscule d’ekphraseis des statues antiques de Constantinople fondues par les croisés en 1204, peut être considéré comme le témoin d’une esthétique de la contrainte virtuose et de hauts standards littéraires. Ce texte a été employé comme source par de nombreux chercheurs, tant historiens qu’historiens de l’art (Reinach, Grecu, Cutler, Dagron, Papamastorakis), et encore tout récemment dans le projet « Byzantium1200 », projet de reconstitution virtuelle en 3 dimensions du paysage monumental de Constantinople (www.arkeo3d.com/byzantium1200). L’éclairage que nous souhaitons donner à ce texte est moins historiographique que littéraire : en partant d’une double source, les conclusions de Gilbert Dagron sur la relation des Byzantins aux statues et les travaux de Martin Steinrück qui montrent l’existence et le maintien de deux traditions opposées, le style catalogique et le style périodique de l’époque archaïque à l’époque byzantine, nous souhaiterions souligner le caractère poïétique, (auto)référentiel et théorique de certains passages du De signis. De fait, on peut déceler une lecture assez fine de ces deux traditions formelles décrites par Aristote (Rhétorique et Poétique), que Nicétas réutilise pour les mettre au service de sa prose dans une allégorie de la Rhétorique, qui ne représenterait donc pas une statue réelle mais une figure inventée pour les besoins de sa prosopopée. L’enjeu est une mise en évidence de nos concepts de norme, de vérité et de mensonge dans l’écriture de l’Histoire et, de ce fait, une tentative de comprendre les choix herméneutiques à opérer lors de la lecture et de l’étude d’un texte byzantin.
Salle Walter Benjamin
15h30, Samedi 20 octobre 2012
Christianisme et monde classique dans la Vie et Miracles de Sainte Thècle (Ve siècle)
Ángel Narro, Université de Valence.
La Vie et les miracles de Sainte Thècle est un texte hagiographique divisé en deux parties: la Vie, paraphrase des Actes de Paul et Thècle, et les Miracles, recueil des prodiges de la sainte à son sanctuaire de Séleucie. À l’intérieur du texte nous apprécions une alliance parfaite entre pensée chrétienne et formation classique visible à la langue utilisée par cet auteur anonyme qui consacra son talent à Thècle. Les citations provenant du monde classique et des textes chrétiens se mélangent dans cet ouvrage, entourées d’un langage riche et orné qui rappelle souvent la rhétorique grecque ancienne, en créant un récit où Homère et d’autres auteurs païens apparaissent à côté des évangélistes ou des Pères de l’Église.
D’un côté, nous avons réalisé l’analyse linguistique du texte, qui révèle la présence de quelques traits phonétiques propres de l’atticisme, de formes duelles, d’une grande quantité de verbes en -ιζω et -αζω, de jeux de particules et d’une syntaxe surchargée et pleine de participes et de phrases subordonnées. De l’autre, nous avons souligné l’abondance d’allitérations, anaphores, anadiploses, paronomases, homéotéleutes et d’autres figures de style qui rattachent notre auteur aux écoles de rhétorique et de grammaire de son époque où les savants qui se sont occupés du texte auparavant l’avaient déjà placé.
Salle Walter Benjamin
16h30, Samedi 20 octobre 2012
Historiographic rewriting: the main tendencies in Peter the Patrician
(VIthc.)
Dariya Rafiyenko, Université de Cologne.
The Byzantine historians considered the reception and treatment of the works of their predecessors as one of their main tasks. This aspect of the historiography, referred to as historiographic rewriting, implies a complex process of updating and compiling, summarizing and paraphrasing, adding and excising the historiographic data. The reasons for such a “flexible” approach to historiographic rewriting was assumedly to accommodate the historiographic knowledge to the changing needs of the society, where political, social and religious reorganization took place. This presupposes that the rewriting was a conscious creative act that had its literary, ideological and cultural reasons and that this act is worth of independent research.
The present speech aims to show the main tendencies in the historiographic rewriting that can be observed in the historical fragments of Peter the Patrician, a Late Antique or rather Early Byzantine official, diplomat and historian of the 6th century. His historical work, now extant in a considerable number of fragments, dealt with the history of the Roman Empire probably beginning with the second half of the 1st century BC and reaching at least the 4th century. His main source for the period from about 42 BC to 229 AD was the Roman History of Dio Cassius (ca. 150 – 229 AD). Following rather close to the narrative of Dio, Peter still shows considerable discrepancies with regard to his source. A thorough analysis of these discrepancies can show us the probable motivation for the main classes of the changes that can be observed. On the basis of this analysis I will try to show that reshaping the narrative on various levels, simplification and alteration of the content as well as ideological restructuring of the content belong to the main consequences I could observe.
Salle Walter Benjamin
17h00, Samedi 20 octobre 2012
La correspondance copte de Dioscore d’Aphrodité (VIe siècle, Moyenne Égypte).
Loreleï Vanderheyden, École pratique des hautes études.
En 1905, Gustave Lefebvre, alors inspecteur des antiquités égyptiennes, découvre une jarre pleine de papyrus, lors d’une fouille officielle entre Assiout (Lycopolis) et Akhmim (Panopolis), dans le village de Kûm Ishqâw (anciennement Aphrodité). Plus de six cent cinquante documents écrits en grec et en copte au VIe siècle de notre ère sont alors mis au jour.
Très vite les différents spécialistes s’aperçoivent que la personnalité centrale de cet ensemble était un certain Dioscore, fils d’Apollôs, et qu’il était le rédacteur d’une partie des documents de la jarre de Kûm Ishqâw. Les documents de la jarre, c’est-à-dire ses papiers d’affaire, sa correspondance, ses poèmes mais aussi sa bibliothèque, sont aujourd’hui désignés par l’expression « archives de Dioscore ».
Ce lot a suscité dès sa découverte un double intérêt, à la fois littéraire et historique, car cet ensemble a livré d’une part, le premier exemplaire bien conservé de certaines comédies de Ménandre et d’autre part, six cent documents de tous genres couvrant tous les aspects de l’histoire sociale, administrative, économique et religieuse de cet important village de Thébaïde, avant que ce dernier ne passe sous la domination arabe.
Pourtant, un siècle de recherches et de publications sur les archives de Dioscore n’a pas encore permis d’appréhender le dossier dans sa totalité ni d’épuiser les multiples facettes du plus important ensemble de documents que nous possédons pour l’Égypte byzantine. Bien que certains textes nouveaux restent à éditer, la partie grecque des archives est largement connue et documentée. Le versant copte a été quant à lui largement sous-estimé : il a fallu attendre les travaux pionniers de Leslie MacCoull, dans les années 1980 et 1990 pour que le corpus copte sorte quelque peu de l’indifférence où il avait été jusque là cantonné. Cette lacune nous prive pour l’instant d’une compréhension globale des archives de Dioscore. Mon travail se propose donc, en améliorant la connaissance des pièces coptes, de réduire ce déséquilibre et de parvenir à une meilleure intégration des deux composantes de ces archives.
Ces sources complètent, en effet, parfois les documents grecs, et apportent également à l’étude de ces archives un éclairage neuf sur le contexte socio-culturel de l’histoire du village d’Aphrodité. Ils mentionnent notamment des personnages absents des sources grecques, permettant ainsi une meilleure identification prosopographique de cette région, dans la mesure où les lettres coptes privées documentent une partie de la population absente des textes administratifs grecs. Ces documents présentent donc des réalités et des caractères différents de ceux présents dans les écrits officiels. Ces papyrus coptes ont également un intérêt linguistique certain : ils posent le problème de l’usage du copte dans une société où, si le copte était la langue parlée, le grec était celle de l’administration. Or les archives de Dioscore sont parmi les premières à établir le rapport entre ces deux langues. Je cherche donc à comprendre pourquoi une telle différence existe entre ces deux versants d’un même ensemble archivistique : l’étude de ces lettres aidera à comprendre qui avait recours à cette langue, dans quelles conditions et pour quels types de documents. En d’autres termes, elle posera le problème des rapports entre la langue nationale des Égyptiens et celle du pouvoir byzantin, à une époque où la première commence à gagner du terrain sur la seconde dans le domaine des actes juridiques.
Je rassemble donc le corpus des lettres coptes des archives de Dioscore sous la forme d’une édition commentée. Les lettres constituent, en effet, le type documentaire le plus représenté dans la composante copte de ces archives. Par ailleurs, dans la mesure où elles sont presque toujours privées, elles complètent le pan grec où ces dernières sont quasiment absentes.
Le corpus des lettres coptes compte une trentaine de pièces éditées et au moins une dizaine d’inédits déjà repérés. La réédition des premières, que je me propose de collationner avec les originaux devrait apporter de nombreux gains textuels et faire progresser leur compréhension. Quant aux inédits, ils appartiennent principalement aux collections des Musées Égyptien et Copte du Caire, de Londres et de Berlin. Un travail d’heuristique dans les diverses collections qui contiennent des papyrus des archives de Dioscore devrait me permettre, je l’espère, d’en augmenter le nombre, la totalité du pan copte des archives n’ayant pas été complètement explorée. Cette édition sera accompagnée d’une synthèse qui posera le problème du rapport entre langue grecque et copte dans un milieu villageois du VIe siècle, comme celui d’Aphrodité. Elle étudiera le dialecte copte en usage dans cette région et analysera les données historiques susceptibles de compléter celles livrées par les archives grecques.
Les différents sujets soulevés par cette étude sont susceptibles d’intéresser nombre de spécialistes : non seulement les papyrologues et coptisants, mais plus largement les historiens de l’Antiquité tardive, du monachisme et du bilinguisme, problématique centrale de mon travail.