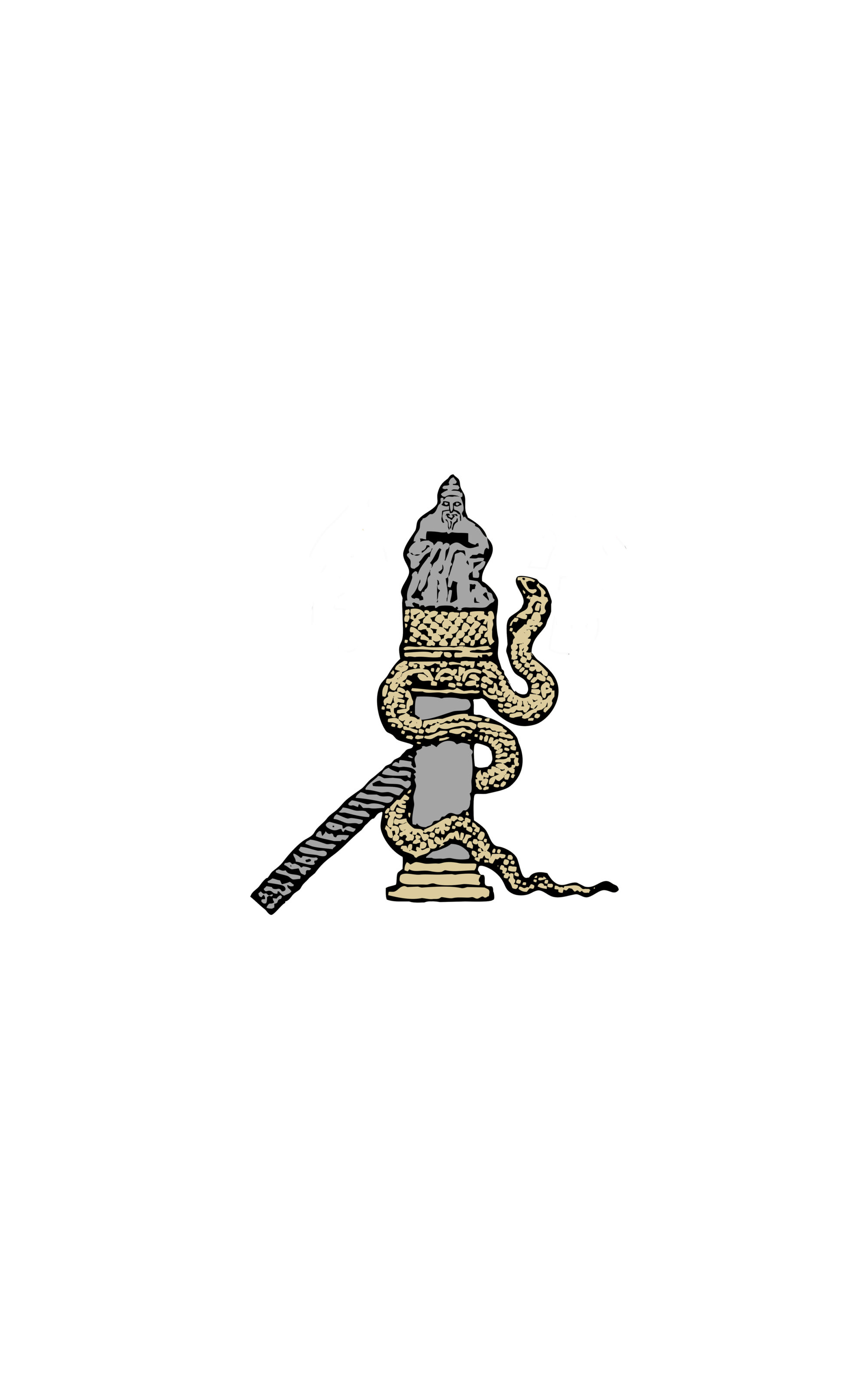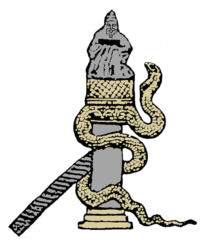La culture matérielle de la transition copto-byzantino-islamique en Égypte, du VIIe au IXe siècle.
Julie Marchand, Université de Poitiers.
Le titre exact de la thèse en préparation est « Recherches sur les phénomènes de transition de Égypte copto-byzantine à l’Égypte islamique. La culture matérielle ». L’enjeu de cette recherche est de cibler la culture matérielle, grâce aux objets issus de fouilles anciennes et récentes, afin de mieux interpréter une époque jusqu’ici encore appelée de « transition », fort méconnue, souvent moins bien appréhendée lors des fouilles archéologiques.
L’étude de la culture matérielle permet de visualiser les objets du quotidien qui sont de bons indicateurs des changements politiques qui ont eu lieu en Égypte. Ils contribuent à déterminer quels ont été les héritages byzantins ou coptes sauvegardés, et quelles ont été les nouveautés apportées par les conquérants.
La problématique du sujet est donc d’expliquer les différents types de mobiliers, de déterminer quels sont leurs héritages exacts, et par quelles transformations, les objets deviennent-ils ceux que l’on attribue à l’époque islamique. Nous pourrons ainsi avancer les critères qui définissent les attributions culturelles (technique, iconographie, usage, fonction) lorsque cela sera possible, et s’il est utile d’en donner une. L’occasion est aussi donnée de faire un point sur le terme de « transition », de le définir au mieux, notamment par ses dates. Une telle étude sera aussi l’occasion de remettre le changement de religion du pouvoir en place dans un contexte domestique.
Enfin, nous pourrons présenter quelques objets caractéristiques de la période de divers matériaux, notamment de la vaisselle céramique, à travers les siècles qui nous intéressent. Quelques sites archéologiques de référence seront présentés et constitueront un support contextuel.