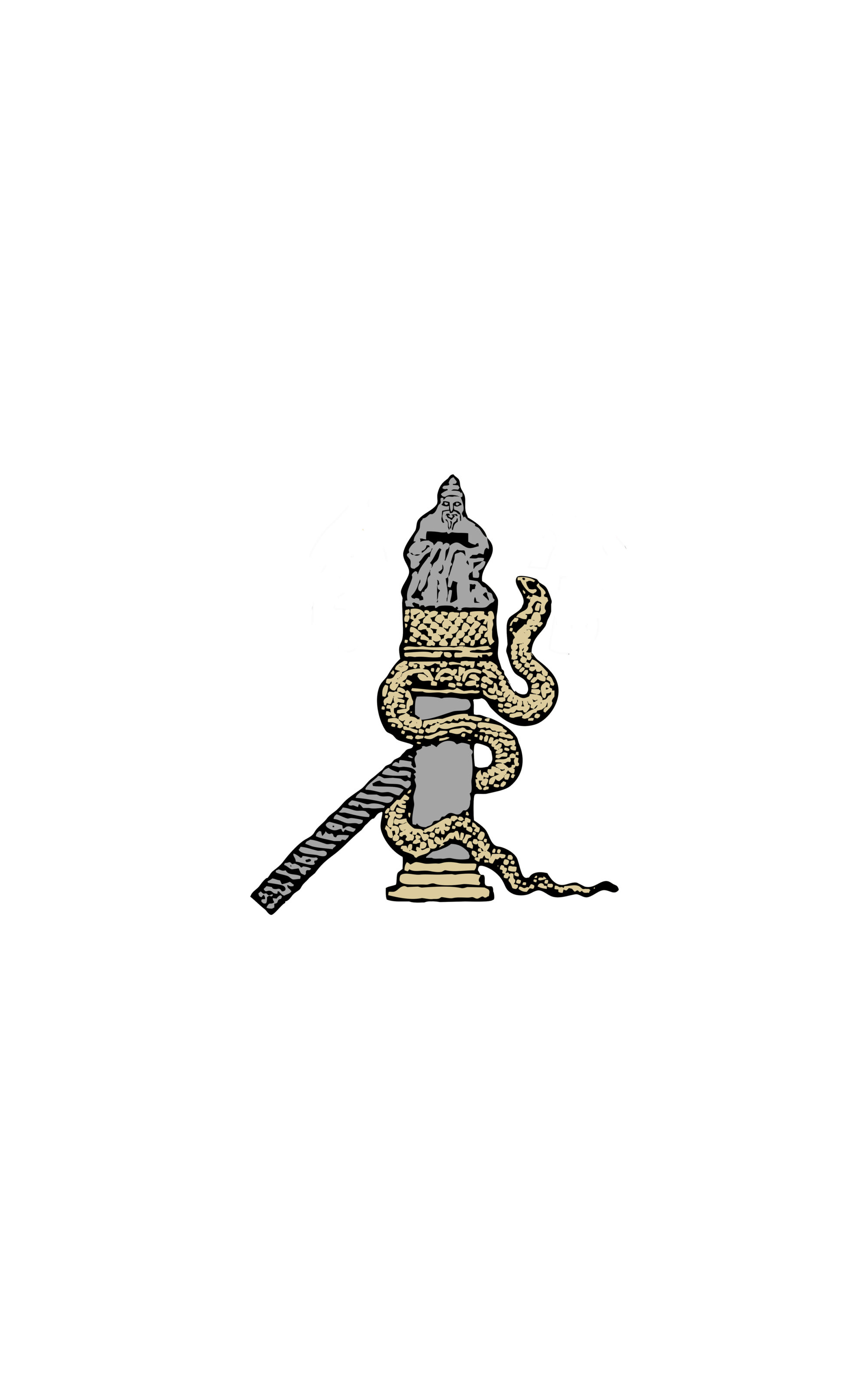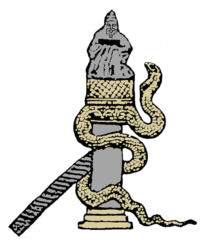L’urbanisme médiéval de la ville de Zadar à l’époque du pouvoir byzantin en Dalmatie.
Iva Rukavina, Université Paris Ouest – Nanterre La Défense
L’objectif de cette présentation, dont le contenu est issu de nos recherches dans le cadre de notre thèse, est de montrer les relations entre l’Empire Byzantin et la ville de Zadar à l’époque médiévale, notamment à travers les modifications urbaines qu’a subies la ville à cette période historique.
Zadar est située sur la côte adriatique orientale en Croatie. Le noyau historique de la ville actuelle est situé sur la petite presqu’île qui ferme la baie dans laquelle se trouve le port. Les vestiges archéologiques les plus anciens datent du IXe siècle av. J.C. Pendant la période romaine, Zadar (Iadera) a été l’un des centres les plus importants de la côte adriatique orientale. La ville antique a été conçue suivant les schémas romains, ce qu’atteste le réseau orthogonal de voies toujours conservé.
Le pouvoir byzantin instauré à la fin de l’époque de l’Antiquité tardive caractérisera l’époque médiévale jusqu’au début du XIIe siècle, période pendant laquelle Zadar occupera une position particulière au sein de la Dalmatie. Peu affectée par les invasions barbares, la ville gardera son aspect urbain pendant l’époque médiévale et sera dotée de nombreux bâtiments nouveaux, à caractère sacré en particulier.
La description de Zadar datant du milieu du Xe siècle et attribuée à l’empereur byzantin Constantin VII Porphyrogénète, dans le chapitre 29 de son ouvrage De Administrando Imperio, constitue une des sources les plus importantes pour connaître l’urbanisme médiéval de la ville de Zadar.