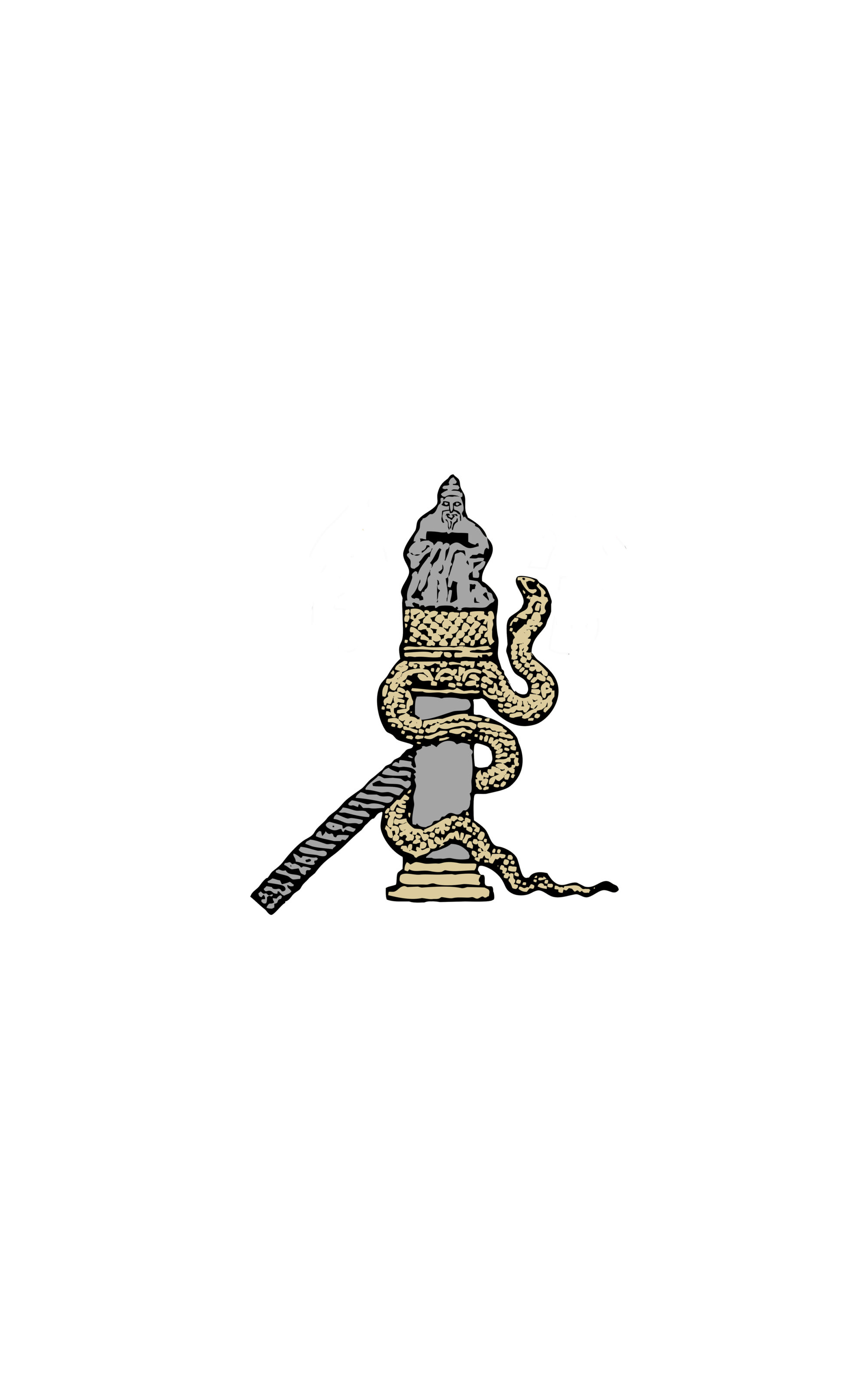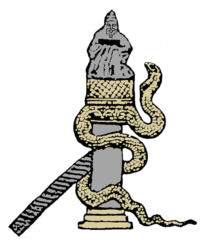La fête des Broumalia de Rome à Byzance : continuité ou ré-invention idéologique ?
Elena Nonveiller, École des Hautes Études en Sciences Sociales
L’État et l’Église romains d’Orient, dans son histoire millénaire, ont alterné la tendance à interdire et condamner toute une série de fêtes, rites et pratiques religieuses non officielles, dites ‘païennes’ ou ‘démoniaques’, en tant que dangereuses pour la stabilité politique et sociale, avec la tendance à masquer leur hétérodoxie en les assimilant. Très souvent ces formes d’intégration ont produit des synthèses et des syncrétismes religieux très originels, où le paganisme n’est plus dissociable du christianisme. Lorsque les byzantins ont rétabli la célébration de certaines fêtes antiques, ils les ont élaboré et transformé pour les réadapter dans le nouveau contexte historique et socioculturel. Ces adaptations sont passées à travers une forme de ré-invention idéologique du paganisme gréco-romain, en raison de marquer chaque fois une continuité ou une fracture avec le passé pré-chrétien, conformément aux exigences économiques, politiques et sociales du présent. C’est le cas de l’ancienne fête romaine de la bruma qui a été transformée en Broumalia par les Byzantins, à travers un processus de ré-invention idéologique de l’Antiquité.
Dans la présente communication je me propose de remarquer certains aspects de ce processus par l’analyse de deux sources byzantines sur les Broumalia à différentes époques : l’une, au VIe siècle, constituée par la Chronique de Jean Malalas (récit du livre VII consacré à la fondation de Rome et à la création de rites et cultes par Romulus), l’autre, au Xe siècle, constitué par le Livre des cérémonies de Constantin VII Porphyrogénète (chapitre 18 du tome II de l’édition de J.J. Reiske, consacré à la description de la cérémonie solennelle du broumalion impériale).