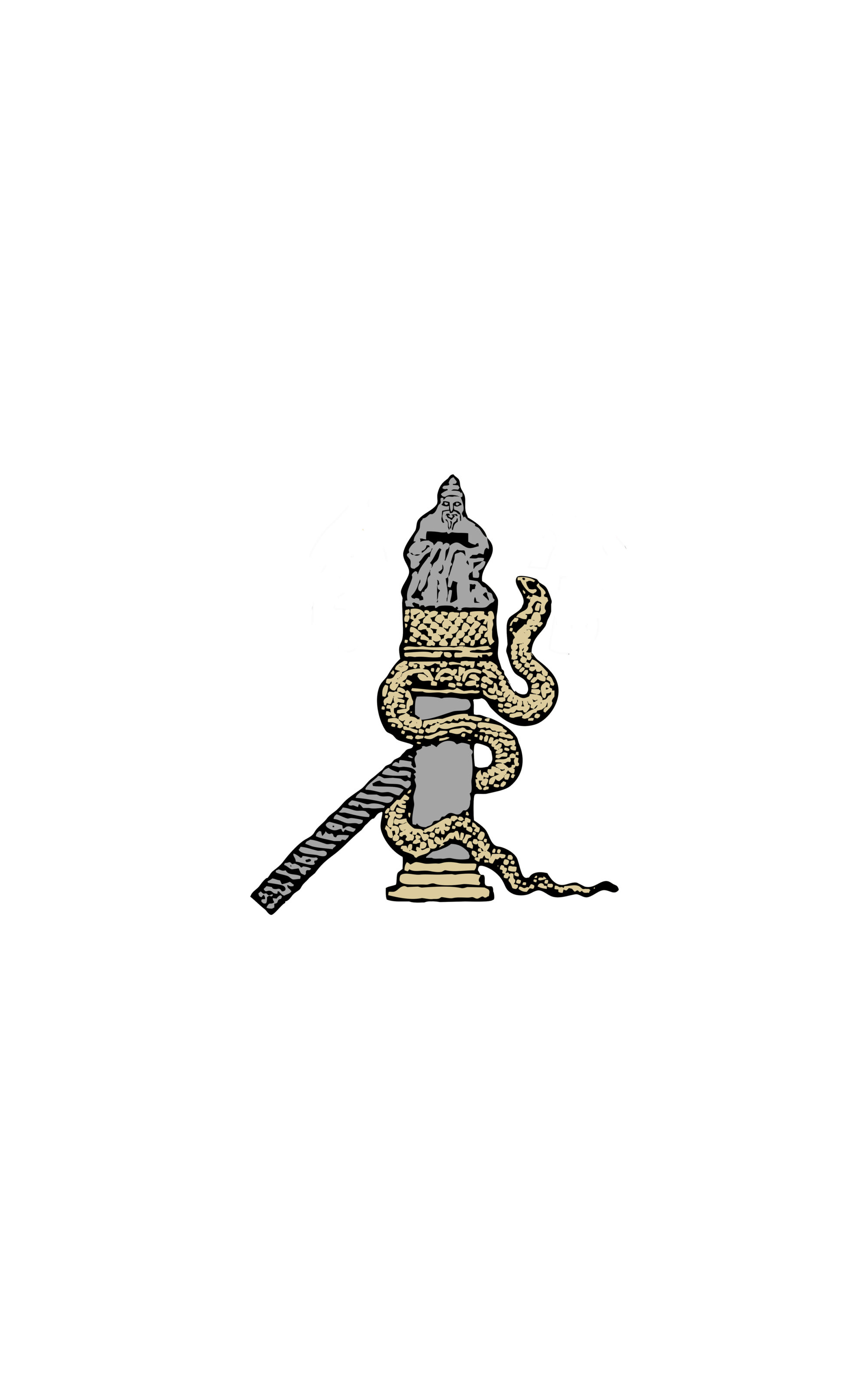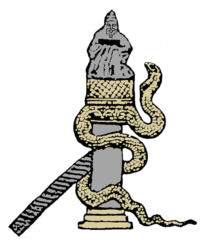Ammaedara (Tunisie) : la ville byzantine, état des connaissances.
Elsa Rocca (Université de Paris IV-Sorbonne)
Dans le cadre d’un doctorat en archéologie sur l’agglomération antique d’Ammaedara et sa campagne (village actuel d’Haïdra, situé au centre ouest de la Tunisie), une communication portant sur la ville de l’Afrique byzantine peut être proposée. Un exposé sommaire du site à travers les problématiques développées par le sujet de thèse pourrait précéder la présentation des données connues sur la cité byzantine et les questions associées à cette thématique. Les limites chronologiques du sujet correspondent à la fondation de la colonie au Ier siècle de notre ère et à la conquête islamique au milieu du VIIe siècle, qui met fin à la présence byzantine en Afrique. La cité est intégrée dans l’Empire byzantin au milieu du VIe siècle avec la reconquête du nord de l’Afrique par Justinien. Un certain nombre d’édifices témoigne de la permanence de la ville au VIe et au VIIe siècle, comme la citadelle justinienne, plusieurs églises restaurées ou construites à cette époque ou encore l’arc dit de Septime Sévère transformé en bastion à l’entrée de la ville. Les monuments byzantins d’Ammaedara sont signalés dès le début du XIXe siècle par les premiers explorateurs et archéologues. Dans les années 1960, les églises ont fait l’objet des premiers travaux de la Mission archéologique à Haïdra sous la direction de Noël Duval. La citadelle et ses aménagements intérieurs sont étudiés depuis 1991 dans le cadre de la Mission franco-tunisienne dirigée dorénavant par le professeur François Baratte et par le Directeur Général de l’Institut national du patrimoine, Fathi Béjaoui. L’étude de ces monuments dans le cadre de la thèse s’intègre à une réflexion sur la topographie, sur les transformations du paysage urbain et les limites de l’agglomération, que l’on tente d’analyser en relation avec l’occupation de la proche campagne.