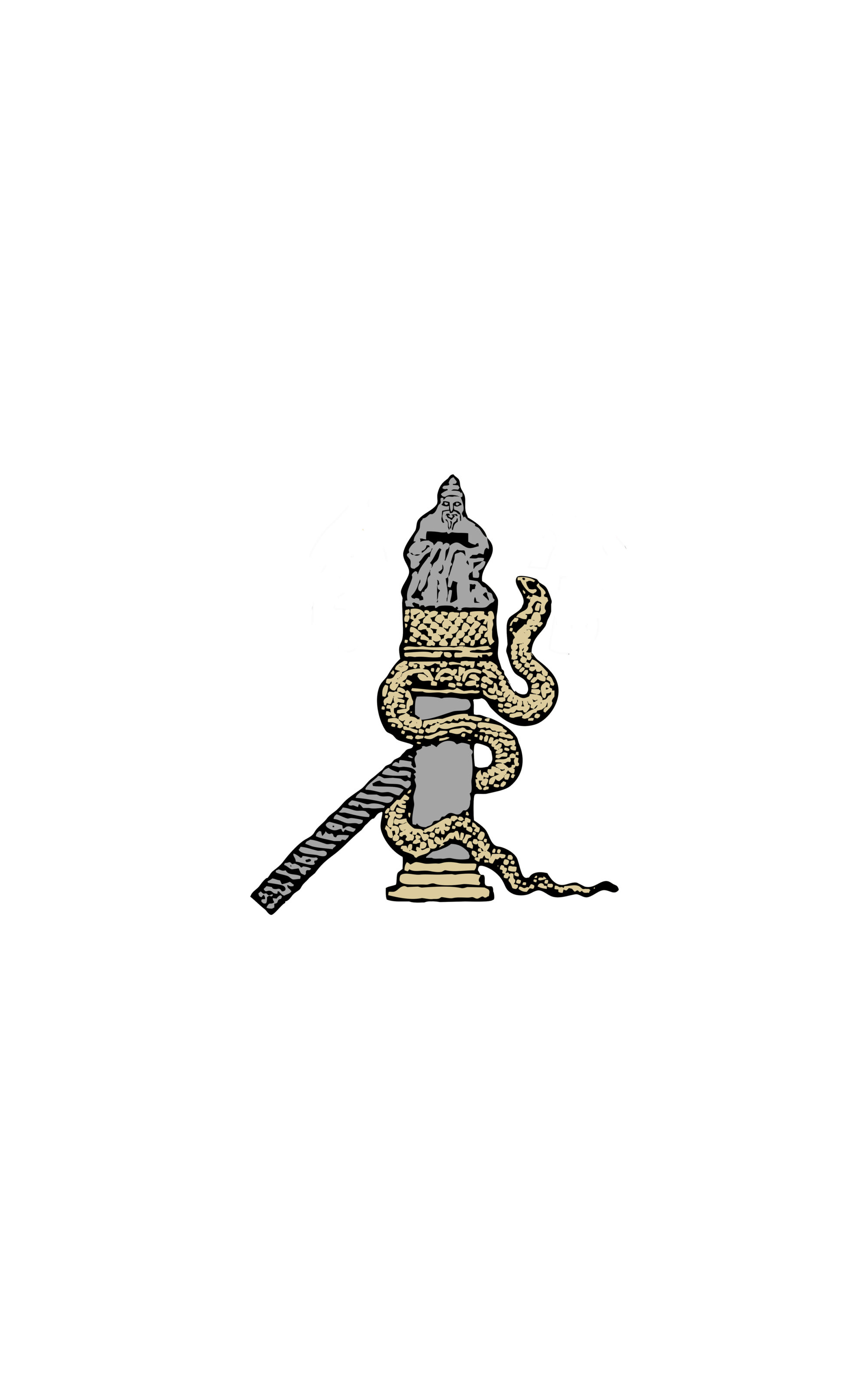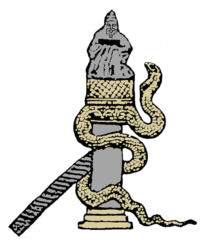La correspondance copte de Dioscore d’Aphrodité
(VIe siècle, Moyenne Égypte).
Loreleï Vanderheyden, École pratique des hautes études.
En 1905, Gustave Lefebvre, alors inspecteur des antiquités égyptiennes, découvre une jarre pleine de papyrus, lors d’une fouille officielle entre Assiout (Lycopolis) et Akhmim (Panopolis), dans le village de Kûm Ishqâw (anciennement Aphrodité). Plus de six cent cinquante documents écrits en grec et en copte au VIe siècle de notre ère sont alors mis au jour.
Très vite les différents spécialistes s’aperçoivent que la personnalité centrale de cet ensemble était un certain Dioscore, fils d’Apollôs, et qu’il était le rédacteur d’une partie des documents de la jarre de Kûm Ishqâw. Les documents de la jarre, c’est-à-dire ses papiers d’affaire, sa correspondance, ses poèmes mais aussi sa bibliothèque, sont aujourd’hui désignés par l’expression « archives de Dioscore ».
Ce lot a suscité dès sa découverte un double intérêt, à la fois littéraire et historique, car cet ensemble a livré d’une part, le premier exemplaire bien conservé de certaines comédies de Ménandre et d’autre part, six cent documents de tous genres couvrant tous les aspects de l’histoire sociale, administrative, économique et religieuse de cet important village de Thébaïde, avant que ce dernier ne passe sous la domination arabe.
Pourtant, un siècle de recherches et de publications sur les archives de Dioscore n’a pas encore permis d’appréhender le dossier dans sa totalité ni d’épuiser les multiples facettes du plus important ensemble de documents que nous possédons pour l’Égypte byzantine. Bien que certains textes nouveaux restent à éditer, la partie grecque des archives est largement connue et documentée. Le versant copte a été quant à lui largement sous-estimé : il a fallu attendre les travaux pionniers de Leslie MacCoull, dans les années 1980 et 1990 pour que le corpus copte sorte quelque peu de l’indifférence où il avait été jusque là cantonné. Cette lacune nous prive pour l’instant d’une compréhension globale des archives de Dioscore. Mon travail se propose donc, en améliorant la connaissance des pièces coptes, de réduire ce déséquilibre et de parvenir à une meilleure intégration des deux composantes de ces archives.
Ces sources complètent, en effet, parfois les documents grecs, et apportent également à l’étude de ces archives un éclairage neuf sur le contexte socio-culturel de l’histoire du village d’Aphrodité. Ils mentionnent notamment des personnages absents des sources grecques, permettant ainsi une meilleure identification prosopographique de cette région, dans la mesure où les lettres coptes privées documentent une partie de la population absente des textes administratifs grecs. Ces documents présentent donc des réalités et des caractères différents de ceux présents dans les écrits officiels. Ces papyrus coptes ont également un intérêt linguistique certain : ils posent le problème de l’usage du copte dans une société où, si le copte était la langue parlée, le grec était celle de l’administration. Or les archives de Dioscore sont parmi les premières à établir le rapport entre ces deux langues. Je cherche donc à comprendre pourquoi une telle différence existe entre ces deux versants d’un même ensemble archivistique : l’étude de ces lettres aidera à comprendre qui avait recours à cette langue, dans quelles conditions et pour quels types de documents. En d’autres termes, elle posera le problème des rapports entre la langue nationale des Égyptiens et celle du pouvoir byzantin, à une époque où la première commence à gagner du terrain sur la seconde dans le domaine des actes juridiques.
Je rassemble donc le corpus des lettres coptes des archives de Dioscore sous la forme d’une édition commentée. Les lettres constituent, en effet, le type documentaire le plus représenté dans la composante copte de ces archives. Par ailleurs, dans la mesure où elles sont presque toujours privées, elles complètent le pan grec où ces dernières sont quasiment absentes.
Le corpus des lettres coptes compte une trentaine de pièces éditées et au moins une dizaine d’inédits déjà repérés. La réédition des premières, que je me propose de collationner avec les originaux devrait apporter de nombreux gains textuels et faire progresser leur compréhension. Quant aux inédits, ils appartiennent principalement aux collections des Musées Égyptien et Copte du Caire, de Londres et de Berlin. Un travail d’heuristique dans les diverses collections qui contiennent des papyrus des archives de Dioscore devrait me permettre, je l’espère, d’en augmenter le nombre, la totalité du pan copte des archives n’ayant pas été complètement explorée. Cette édition sera accompagnée d’une synthèse qui posera le problème du rapport entre langue grecque et copte dans un milieu villageois du VIe siècle, comme celui d’Aphrodité. Elle étudiera le dialecte copte en usage dans cette région et analysera les données historiques susceptibles de compléter celles livrées par les archives grecques.
Les différents sujets soulevés par cette étude sont susceptibles d’intéresser nombre de spécialistes : non seulement les papyrologues et coptisants, mais plus largement les historiens de l’Antiquité tardive, du monachisme et du bilinguisme, problématique centrale de mon travail.